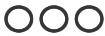De la mer de corail à la mer d'Andaman - Dominante: manque de vent
Fin août, après une traversée "vigoureuse" depuis les Fidji, nous avons touché Nouméa. L'année sabbatique de Brigitte touchant à sa fin, elle profita de ses deux dernières semaines pour découvrir la Nouvelle-Calédonie et s'envola pour la France. Mon projet initial était de m'installer pour six mois dans le territoire. Je voulais attendre la prochaine mousson de sud-est et réinitialiser la caisse du bord en travaillant sur place. J'ai assez vite déchanté. Les places d'informaticien vacantes que l'on m'avait annoncées nombreuses s'avérèrent inexistantes. Certes, en persévérant, j'aurais pu dénicher un job, mais le coût de la vie prohibitif m'effraya et je décidai assez rapidement de reprendre le large pour rallier directement la Thaïlande.
Les conditions n'étaient pas idéales. La période de la mousson de sud-est s'achevait. Nous entrions dans une période intermédiaire où les vents sont aléatoires en force et en direction. La route qui menait à Phuket me semblait bien longue et assez difficile pour un solitaire : 5000 milles de mers fréquentées surtout à partir de Bali, et deux passages malaisés : le Détroit de Torres et le Détroit de Malacca. L'installation d'un radar, que je fis venir de France par les soins de Victor Tonnerre, me rassurait un peu. Il allait me permettre de dormir plus paisiblement, car l'alarme intégrée à l'appareil devait me réveiller à la présence d'un écho suspect dans la zone de surveillance. Ce système s'avéra d'ailleurs assez efficace, excepté au moteur, car le niveau sonore de l'alarme n'était pas suffisant pour couvrir le bruit de la machine.
19 septembre : Appareillage. Les adieux à mes amis calédoniens ont été fêtés la veille dans les règles. C'est par un vent nul et la "tête dans le sac" que je sors de bonne heure du grand lagon sud par la passe de Dumbéa. Passée la période euphorique du départ et l'ouvrage qui l'accompagne afin de transformer une caravane flottante en un voilier transocéanique sûr et confortable, je réalise que je suis seul à bord et cela pour un petit moment. Il n'y a ni joie ni angoisse dans ce simple constat. Le vent ne se décide pas à souffler et c'est au moteur que je perds de vue la côte de la Nouvelle-Calédonie. L'alizé, énergique depuis un mois, cesse son activité le jour de mon départ. Bateau immobilisé, mer d'huile, pour cette première nuit en mer, le sommeil n'est pas au rendez-vous. Je n'ai pas encore expérimenté le radar et dans cette zone fréquentée, je ne me risque pas à dormir plus d'un quart d'heure d'affilée. Matelas sur le pont, la tête vers les étoiles, je cale mon rythme de repos sur les aiguilles de ma montre.
Au lever du jour, un contact radio avec Jean-Louis, ami navigateur en escale à Nouméa, m'apprend que les prévisions météo ne sont pas fameuses : rien ne laisse présager du vent pour les prochains jours. En effet, Éole me réserva trois jours de petit temps. J'alterne voile et moteur et essaye de capter la moindre brise. J'expérimente les nombreuses possibilités de voilure de la goélette. Je répartis mon activité entre les manœuvres de voile, les conversations radio, la cuisine, l'entretien et surtout la lecture. La bibliothèque du bord, quoique bien garnie, commence à perdre de sa richesse. J'en ai lu la plupart des volumes, relus certains, et me plonge avec délectation dans des classiques du 19ème, Zola, Balzac et Huysmans, achetés juste avant le départ.
Le petit ordinateur du bord me donne quelques soucis. Un virus informatique, introduit je ne sais où, menace dangereusement son intégrité. Après plusieurs heures de dépistage intensif, je viens à bout du redoutable vibrion. Une autre de mes activités, quoique aléatoire, c'est la recherche de ma pipe. C'est fou ce qu'un bateau peut contenir comme cachettes à pipe. À croire que ce morceau de Bakélite et de bois est vivant et s'ingénie à se dissimuler pour éviter le bûcher. Fous à bord ! La visite bruyante et quelque peu salissante d'une bande de fous de Bassan marque le retour de l'alizé. Dans la nuit, lorsque je me réveille pour un tour de veille, je distingue une forme noire sur le dessus de la capote. Je pense y avoir laissé traîner une serviette. J'avance ma main pour la saisir et suis brutalement mordu par un animal qui s'échappe en braillant. Plusieurs de ses congénères, affalés sur le pont, profitent de l'aubaine d'un grand perchoir. C'est au petit matin que je découvre le pont maculé de guano. Le vent est bon, j'établis toute la voilure pour filer un bon 6 nœuds au grand largue et armé d'une brosse et d'un seau, j'efface les traces de mes augures nocturnes.
J'ai faim en permanence. Sans faire de grand repas, je grignote toutes les deux heures. Le pain et les fruits de Nouméa se gâtent rapidement. L'amie du navigateur solitaire, c'est la soupe au nouilles chinoise nouveau conditionnement. J'en ai fait un sérieux approvisionnement et m'en délecte. La préparation en est sommaire : remplir d'eau bouillante un bol en plastique fourni et y mettre le contenu de trois petits sachets, couvrir et attendre trois minutes, c'est prêt, bon et nourrissant. Avec l'arrivée de la brise, la température devient plus supportable, mais l'absence de frigo me prive cruellement de boissons fraîches. Les nuits sont maintenant plus paisibles. J'ai pu enfin expérimenter le radar. Il m'a sorti de ma couchette et j'ai reconnu à environ trois milles les feux d'un navire en route. Lorsque le vent est régulier, je me couche vers 20 heures et toutes les trois heures, je sors observer la marche du bateau. Le sommeil me reprend rapidement et je n'ai nul besoin de réveil pour conserver ce rythme.
La solitude n'est finalement pas si difficile à supporter. Je pense que les conversations radio presque quotidiennes y sont pour beaucoup. Je reçois régulièrement des informations météo par Olivier en escale à Hawaii. La réception n'est pas toujours excellente, et parfois les voix sont totalement inaudibles. Jean-Louis fait le relais. Quelquefois, je capte les deux versions, celle d'Olivier puis celle de Jean-Louis. Je constate souvent des petites différences, Jean-Louis ayant une approche plus optimiste des prévisions. L'heure la plus difficile : la tombée de la nuit. C'est là où la bête insidieuse vient me narguer : le cafard. Ce n'est ni précis ni dirigé, je me sens seul mais n'ai pas vraiment envie d’avoir quelqu'un auprès de moi. Alors j'utilise mes deux remèdes : l’apéro du soir, généralement un whisky tiède et bien tassé, et j'écoute une cassette de "rien à cirer". Dans la plupart des cas, avec ce traitement, l’amertume s'efface.
Tangon brisé. L'alizé, pas très régulier depuis son apparition, m'obligeant à de fréquents réglages de voilure, fraîchit à l’approche du détroit de Torres. Après 10 jours de navigation, à environ 500 milles du détroit, coup sur coup, je pêche une jolie petite bonite et plie mon tangon. Le tube en aluminium s'est enroulé autour d'un bas-hauban et c’est avec beaucoup de difficultés que je rentre le génois et réussis à le dégager. Déprime, sans lui la navigation au vent arrière s’annonce laborieuse. J’ai bien un autre tangon mais il est trop court pour bien dégager le grand foc aux allures portantes. Le vent est très inégal et oscille entre 15 et 25 nœuds. La mer est houleuse, le voilier roule bord sur bord et je ne suis pas très content de l’établissement de la voilure. Comme la direction du vent est elle aussi fluctuante, je fais un réglage médium ce qui n'est pas vraiment satisfaisant. La nuit tombe sur ce temps bouché et crachineux. Le génois claque parfois lorsque nous descendons la vague, ça m'énerve mais que faire ? Un bon fauteuil au coin du feu, une cassette vidéo genre "tonton Flingueur", le chien allongé sur les charentaises, en sirotant un petit verre de Négrita...
Ce dimanche matin me voit plus optimiste. 215 milles avant Torres, j'ai trouvé dans les fonds un bout de tube alu qui pourrait bien me permettre de remettre en état le tangon. C’est en achevant la réparation à grand renfort de rivets que j'apprends par une radio australienne en langue française que notre président Chichi a une nouvelle fois procédé à un tir nucléaire à Mururoa. L'accueil à Darwin risque de n'être que plus "chaud". J’ai ressorti le sextant, essuyé la poussière et effectué une droite de hauteur. Je n'ai pas obtenu de résultats très brillants. Tout est moite et la grisaille du temps a effacé toutes les couleurs. 91 % d'humidité et parfois des grains violents m'obligent à me réfugier à l'intérieur, suffocant tous les hublots fermés.
Un petit oiseau imprudent s'est accroché à la ligne de traîne. Remonté à bord, il est un peu groggy mais bien vivant, il s'immobilise à l'abri de l'hiloire de roof et récupère. Après deux jours de convalescence, il me quittera sans un adieu.
Les visiteurs du détroit de Torrès. Lundi soir : le phare de Bramble Cay marquant l'entrée du détroit est en vue. Le vent ne m'a pas lâché depuis deux jours et le Pacifique, en caresse d'adieu, m'a gratifié d'une houle bien vigoureuse. De nombreux volatiles, comité d'accueil des îles de Torrès, ont envahi le bord. Plusieurs, perchés sur la vergue de misaine, semblent danser au rythme de la musique diffusée sur le pont. La brise s'enfuit progressivement. Le dernier oiseau resté sur le pic de misaine n'a aucunement l'intention de s'en aller lorsque je tente de l'établir. Est-ce un génie des eaux ? A peine la voile libérée de ses cargues, une forte pluie verticale s'abat sur le pont et le vent disparaît. Réfugié à l'intérieur, tous les hublots fermés, je lance le moteur.
Au petit matin, Bramble Cay est à 40 milles derrière nous. Déjà 24 heures sans dormir, il va falloir carburer si je veux atteindre la sortie avant de m'endormir. La clarté du soleil levant dévoile de nombreuses îles très plates. Les fonds de sable peu profonds donnent à l'eau une couleur émeraude. L'oiseau du pic s'est réfugié sur le dessus de la capote et le teck du pont, maculé de guano, s'apparente au sol d'une basse-cour. Installé à l'intérieur, devant la table à cartes, traçant désespérément des routes optimistes, j'entends un sifflement humain. Fréquemment utilisé à la radio VHF pour appeler un bateau ami, ce sifflement ne me fait pas lever la tête. Pourtant, comme il devient insistant, je monte sur le pont et découvre le long de la lisse arrière, une petite embarcation en aluminium et son unique passager m'adressant un large sourire. Le grand jeune homme blond s'adresse à moi dans un langage que je peux identifier mais dont je n'arrive pas à déchiffrer le moindre mot. Je lui réponds de mon meilleur anglais. Il semble me saisir et dans sa réponse, je crois discerner qu'il souhaite me vendre du gazole. À force de gestes et nombreuses répétitions, le dialogue devient un peu plus clair et finalement je comprends le visiteur : Craignant une panne sèche, il souhaite que je le prenne en remorque jusqu'à une île distante d'une vingtaine de milles. C'est donc quelques heures plus tard que je le lâche au vent de son île. Retrouvant ma solitude, je reste étrangement surpris de cette visite de petit prince.
Le temps est magnifique, mer très calme et bonne brise. Je file toutes voiles dehors. J'ai un peu de mal à profiter pleinement de la beauté du paysage, mer émeraude et myriades de petites îles basses et sablonneuses, car le manque de sommeil se fait durement ressentir. Je m'en veux un peu de ne pas avoir eu le réflexe de donner du courrier à mon visiteur impromptu.
Dernière ligne droite, à la tombée de la nuit, nous pénétrons dans le chenal du Prince de Galles. Mais ce dernier coup de collier n'est pas de la bagatelle. Grains sur grains, éclairs et tonnerre, le vent est passé sud-ouest, juste dans le nez. Vent debout, voiles ferlées et moteur plein gaz, je profite du courant favorable pour gagner la sortie à la vitesse de 8 nœuds sur le fond. Des cargos me croisent ou me doublent, je les devine mal dans les grains et je bénis le radar qui me permet d'estimer la trajectoire des mastodontes et d'éviter les routes de collision. Encore une douzaine de milles avant la mer d'Arafura et c’en est fini du Pacifique. Avec la disparition des grains, le vent est complètement tombé, la mer est d'huile, bientôt, dormir...
Passé le phare de Banda Rock qui marque la sortie du détroit, affalé sur la banquette du carré, attendant en demi-somnolence de m'éloigner un peu de la route des cargos, je me suis écroulé dans les bras de Morphée.
Ultime pêche ? La traversée de la mer d'Arafura jusqu'à Darwin fut calme, trop calme. L'alternance de manœuvres de voiles et de manipulations de tangon pour essayer de capter la brise capricieuse avec la mise en route périodique du moteur pour réaliser des journées de navigation correctes se montra très éprouvante pour les nerfs. Mais la coloration verte de la mer, due à la faiblesse de ses fonds, ainsi que les serpents rayés qui se déplaçaient sur l'eau un peu comme s'ils rampaient sur la terre, m'émerveillait beaucoup. Je fis aussi une pêche miraculeuse et remontai à bord un magnifique espadon d'un mètre soixante-dix de long (rostre compris). D'ailleurs, cela marqua la fin de ma vocation de pêcheur. Des 30 kilos de barbaque succulente, je ne pus en consommer qu'une infime partie, et malgré ma dextérité dans la confection de conserves en pots de verre appertisés dans la cocotte-minute, je dus remettre à la mer la plus grande partie de ce grand poisson magnifique.
Darwin : Confiscations. J'aurais bien aimé éviter l'escale à Darwin en Australie, mais l'utilisation prolongée et un peu inattendue du moteur m'obligea à m'y arrêter pour remettre à niveau les réservoirs de fuel. Le séjour bref et technique. Les autorités tatillonnes mais aimables se saisirent de la totalité de mes vivres frais et mirent sous scellé toutes les conserves à base de porc. Après 4 jours, n'ayant vu de l'Australie qu'une ville aseptisée à la population aimable et très peu concernée par les essais nucléaires du Pacifique, je reprenais ma route dans une mer sans vent. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne réalisais pas une croisière d'agrément mais plutôt un convoyage un peu pénible. Le vent n'était toujours pas au rendez-vous et je passais une partie de la journée, suffocant de chaleur, à estimer la consommation de gazole et à calculer la quantité nécessaire pour arriver à Bali. Le moral était bas, les bières tièdes et le peu de vent qui se manifestait variait fréquemment en force et en direction. Pour améliorer l'ambiance un peu tendue du bord, je constatais qu'un courant contraire d'environ un nœud me ralentissait. Heureusement que les contacts radio, presque quotidiens, avec des amis de Nouméa ou d’Indonésie brisaient un peu la solitude et la monotonie du bord.
La veille de l'arrivée à Bali, au milieu de la nuit, je fus surpris par un méchant grain : averse et vent. Le spi qui m’avait bien déhalé depuis le début de l'après-midi explosa et se coinça en tête de mât. Sous la pluie battante, je besognais sans résultat. Heureusement, le grain cessa aussi soudainement qu'il était apparu et je pus enfourner les restes du défunt spinnaker dans son sac.
Bali : Frustration. La première impression à la vue des côtes indonésiennes fut olfactive : les senteurs de l’Asie, ma terre promise. Hélas, Benoa, port de Bali, n'a pas voulu de moi. Normalement, pour faire escale en Indonésie, il faut être doté d’un « cruising permit », sorte de sauf-conduit dispendieux et long à obtenir. J'en avais fait l’économie et, rassuré par les informations de mes amis navigateurs contactés par radio, je comptais bien obtenir le droit de séjourner quelques jours. Accueilli et guidé par Pascal en escale prolongée, je passais la majeure partie de mon escale à m'expliquer de bureau de douane en bureau d'immigration. Peine perdue, je n'obtins que le privilège de m’approvisionner en gazole et en nourriture fraîche. L'escapade illégale que je fis dans la ville en compagnie de Pascal me laissa un arrière-goût de "revenez-y". La dégustation du pain noir se prolongeait.
Bali-Singapour, dernière grande étape, sera aussi la plus pénible. Le vent n’était plus paresseux, il avait disparu. Piètre consolation, la grande houle de l’océan Indien qui m'avait bercé depuis Darwin s’était apaisée dès l’entrée dans la mer de Java. Espérant toujours un peu de brise et n'ayant pas une autonomie moteur suffisante, je me rongeais le sang à guetter le moindre souffle d'air. Les jours fastes, je pouvais stopper l'engin quelques heures et me déhalais à trois nœuds sur le fond. La veille aussi devint plus contraignante. Une multitude de petits voiliers de pêche, aux immenses voiles bleues, en équilibre sur leur flotteur, se posaient souvent au travers de ma route, m'obligeant à de fréquents détournements. La nuit, c'était les cargos, je longeais la ligne Singapour-Lombok. Allongé sur le pont, je ne dormais que par courts intervalles. Je réalisais assez vite que si je ne voulais pas rester enlisé à sec de carburant en plein milieu de la mer de Java, il fallait que je me réapprovisionne. Une fois de plus, la radio vint à mon secours. Bernard, de Penang où il faisait escale, me signala une petite île, à mi-route entre Bali et Singapour, où les pêcheurs locaux pourraient me dépanner.
Pêcheurs providentiels. Serutu, petite île aux eaux claires et au fond de corail, à proximité de Karimata. C'est là que je mouillais au petit matin à une encablure d'un village de pêcheurs. La veille, j'avais passé une partie de la journée à rechercher sans succès un petit lexique franco-indonésien qui devait se trouver à bord. Les seuls mots de vocabulaire que je connaissais ne me permettaient guère de m'expliquer et d'acheter du gazole. Heureusement, je réussis à capter Bernard et à apprendre le mot providentiel : « solar ». Nanti de ce précieux leitmotiv et de quatre gros bidons rouges, j’allais sur la plage. Accueil chaleureux mais négociations difficiles, je n'avais guère que des dollars qui, aux yeux des pêcheurs, ne représentaient que du papier. Finalement, avec quelques petits cadeaux, ma dernière bouteille de vin, des cigarettes, des tee-shirts et bien sûr les dollars valorisés, j'obtins 100 bons litres du précieux liquide et prenais le large non sans avoir photographié sur leur demande une bonne partie des habitants du village. L'esprit un peu plus léger, j'arrosais l’événement avec un Ti-Punch façon balinaise (remplacer le Rhum par de l’arak).
Sumatra dans le détroit. Certainement le moment le plus angoissant de toute la traversée. Quand je dis que j’ai l’estomac noué, ce n’est pas une image, c’est un gros nœud de cabestan. Le jour va se lever dans une demi-heure et je vais entrer dans le détroit de Singapour. C'est une ville de cargos. Le courant est favorable pour le moment mais imprévisible. Il me reste un peu d'arak et une Guinness pour l'arrivée. Avec le soleil, un Sumatera (sorte de grain violent fréquent dans le détroit de Malacca) vient me cueillir à l'entrée. La visibilité est inférieure à 300 mètres et je dois traverser le double rail de cargos pour atteindre la mouillage des voiliers. Le vent fraîchit, génois roulé à 60 %, deux ris dans l'artimon, misaine affalée, je suis au radar le flot continu des énormes navires qui se suivent à presque se toucher et guette le moment optimum pour traverser la voie montante (si seulement il y avait des passages cloutés). Juste après ce gros-là, c'est bon. Moteur à fond, je passe. Ouf ! c’est bon ce chenal. Un peu moins d’échos sur le radar, je me prépare pour la voie descendante. Zut ! c'est quoi celui-là, ce gros écho qui arrive à toute vitesse. Je monte sur le pont et aperçois son étrave à une centaine de mètres. Grand coup de barre, c'était moins une... et hop, un petit coup d'Arak. La pluie s’est clairsemée et la visibilité s'améliore, de visu ça passe tout seul. Une heure plus tard, mouillé en sécurité, je me sèche et déguste la Guinness.
Dernier round. Après une soirée très arrosée en compagnie d'amis Chinois, j'affrontais une nouvelle fois un mauvais grain et le trafic intense du détroit. De Singapour à Phuket, le vent ne fut pas non plus au rendez-vous. Je ne fis route à la voile que les dernières 24 heures, favorisé par la toute nouvelle mousson de Nord-est. Un court arrêt en Malaisie, près de Kuala Lumpur, la capitale, me permit de revoir des amis français expatriés. À Langkawi, port franc à proximité de la frontière Thaïlandaise, je remis à flot la soute à vivres et à alcool. Mais ces 10 jours de traversée furent surtout marqués par des longues veilles, parfois de 36 heures, sans possibilité de petit somme réparateur. Dans tous ces parages, de jour comme de nuit, la présence de pêcheurs est permanente. Leur trajectoire est aléatoire et parfois leur éclairage insignifiant. Par contre, je n’ai guère eu de mauvaises surprises, la piraterie semble inexistante et les pêcheurs approchés très souriants.