On se retrouve à Sri Lanka...
14-30 janvier 97
J'ai écrit ce texte à partir des notes que j'avais prises sur place, et j'y ai ajouté quelques photos. C'est juste une sorte de compte rendu, incomplet et subjectif, d'une petite parenthèse dans ma vie.
Je l'ai fait d'abord pour moi, pour ne pas oublier. Je l'offre à ceux qui étaient restés à la maison et aussi à ceux que j'ai retrouvés là-bas. Ils sont tous concernés par cette histoire.
Marie-Armelle Paulet-Locard
Lundi 13 janvier 1997
J'ai acheté des sachets de soupe poireaux-pommes de terre, des caoutchoucs pour les bocaux à conserves, de la pâte à crêpes en poudre, un gros sac de bonbons et une bouteille de Bordeaux. Ils seront contents.
J'attends Anne à la sortie de l'école, j'ai 20 minutes d'avance. Après avoir mis dans un pochon tous les papiers sales qui envahissaient la voiture, j'écris un peu, sur mon cahier neuf. Puis je lirai une BD que je rendrai tout à l'heure à la bibliothèque, et j'en emprunterai d'autres, avant de rentrer à la maison.
Il y a du soleil enfin après toutes ces semaines de froid triste et sale. Demain je partirai pour Paris, sac à dos bouclé. Je laisserai derrière moi JP et les filles. Je suppose qu'elles ne seront pas si tristes qu'elles le disent. Elles profiteront certainement bien de mon absence ; elles s'entendent bien avec leur père pour faire des écarts, des petites soirées Mac-Do, télé, ciné, et des petits cadeaux.
Deux semaines de séparation, c'est long. On n'a encore jamais vécu cela. Je vais sans doute être un peu bancale, je penserai à JP, pour qui les jours et les nuits seront bien longs... C'est toujours plus difficile de rester que de partir. Le vide provoqué par le départ de l'autre est bien plus difficile à vivre que son propre départ, et le départ de Younn lui a déjà enlevé un peu de lui-même.
Les "Renault espace" et autres "Twingo" manoeuvrent autour de ma 4L. Je ne sors pas de la voiture, Anne a l'habitude, elle me rejoindra. Les plates-bandes viennent d'être sarclées, alors que pourtant la terre était encore gelée hier ; les jardiniers de la commune sont des magiciens, et feront sortir de cette gadoue un buisson de couleurs. Il ne restera plus qu'à attendre le printemps. Pour l'instant, le soleil tape dans le pare-brise et je ne vois rien à travers les traces de doigts et les dégivrages bâclés. Les enfants ne vont pas tarder à remplir la cour et à se précipiter vers les parents qui attendent...
14 janvier
Ca y est, je suis dans le train. J'ai quitté Rennes à 17 heures 52.
Je ne sais plus qui a dit "nous ne sommes pas seulement responsables de nos enfants, nous sommes coupables de ce qui leur arrive." Si jamais il était arrivé quelque chose à Younn, je serais coupable de l'avoir laissé partir, mais en vérité, j'étais déjà coupable de lui avoir donné la vie. Nous devons tout assumer. Je sais qu'il sera là, bronzé et souriant, heureux. Si il a vécu des souffrances, je ne pourrais de toutes façons pas les mesurer, ni les effacer. Alors je porterais une part de responsabilité. Il vit une expérience tellement décalée par rapport à la vie d'un collégien... Mais il a, comme tous les enfants, un libre arbitre. Il sait faire ses propres choix et les assumer.
Et qui pourra dire que l'on n'a pas assez pesé les dangers de ce voyage ? Et qui peut me dire quelle était la dose du risque ? Je sais que maintenir Younn au collège sans le laisser saisir la chance que lui donnait Bruno aurait eu des conséquences terribles sur nos relations. Pourquoi lui interdire de réaliser un rêve, alors qu'il est réalisable ? Combien d'arguments contre, et tant d'arguments pour...
Lorsque Bruno a proposé à Younn de partir, il était déjà trop tard pour reculer. Il aurait fallu l'empêcher de faire cette proposition, ou trouver tout de suite la parade pour que le rêve avorte immédiatement. Mais cela aurait été tellement hypocrite.
Bruno, c'est mon petit frère (il n'est né qu'un an après moi). Il est exigeant sur le travail et sur la parole. Peu de fantaisie, mais une confiance totale en ceux qu'il a choisi pour amis. Et comme je suis à la fois une sœur et une amie, il n'est pas question ni d'un côté ni de l'autre de douter un seul instant de notre confiance mutuelle. Nous avons des vies très différentes, et pourtant nous sommes tous deux sûrs d'une chose : il faut se donner les moyens d'être heureux. Plus facile à dire qu'à faire... La vie qu'il mène en Thaïlande est peu ordinaire : il est installé avec son ami Nick, avec qui il a déjà vécu une dizaine d'années à Paris. Il a abandonné son métier d'informaticien et est parti pour son tour du monde en bateau. Comme il dit : "on n'a qu'une vie, il faut la remplir au maximum !".
C'était l'été dernier. Nous étions en vacances en Thaïlande, chez Bruno et Nick. Leur appartement est à Phuket, sur une grande rue - Khao Fa Road -, au-dessus de leur salon de coiffure. Ils nous ont accueillis, JP, les enfants et moi, avec toute notre agitation : Marie avec sa personnalité d'adolescente curieuse et pertinente, Younn émergeant du rêve de l'enfance sans ménager son enthousiasme et sa sensibilité et Anne vivant pleinement la joie des vacances en toute liberté. Sans compter notre impatience à vouloir tout visiter et tout essayer dans cet environnement qui nous plaisait vraiment beaucoup à tous les cinq.
Arrêt sur Younn : il a 12 ans, pas très costaud, mais énergique. Il a un visage d'ange et une bonne dose d'humour et de malice qui ne plaisent pas toujours à ses professeurs. La discipline n'est pas son fort mais il respecte ceux qui le respectent. Il est asthmatique et ne se sépare jamais de sa ventoline, sauf quand il l'oublie. Il est distrait, rêveur, planeur.
Bruno était arrivé là par la mer. Il avait quitté Lorient avec son bateau, l'Ilboued, et était venu rejoindre Nick en passant par l'Atlantique, le Pacifique et les mers d'Indonésie. En fait, son installation à Phuket n'était qu'une escale un peu longue, tant qu'il n'avait pas fini son tour du monde. Le moment était maintenant venu de reprendre la mer, mais il ne voulait plus naviguer en solitaire. Le voyage de retour tel qu'il l'imaginait était plutôt attractif : les Maldives, Djibouti, la Mer Rouge, la Grèce, la Corse et le canal du Midi.
Alors Bruno a proposé à Younn de faire le retour avec lui. JP et moi étions d'accord. Voilà. Il partirait de Phuket à Noël et arriverait en Bretagne en juillet.
Le contrat était clair : cours par correspondance obligatoires avec le Centre National d'Education à Distance (ou CNED) imposés par les parents, et interdiction de débarquer en cours de route, dictée par le capitaine.
Younn trouvait ça trop long, six mois sans voir ses parents. JP et moi, nous étions bien de son avis. Alors, sans hésiter :
- On s'arrangera pour aller te retrouver, chacun notre tour, comme ça tu auras deux fois de la visite. D'accord ?
Et voilà Younn se demandant si c'est une proposition honnête et pesant sérieusement le pour et le contre... Il a rapidement fait son choix :
Après un départ déchirant de Phuket, nous avons regagné Bangkok, la décision était entre les mains de Younn. Avant même d'arriver à l'aéroport, il avait choisi. J'irai le rejoindre en Inde, et JP irait le rejoindre en Grêce.
Renseignements pris sur les possibilités d'accoster en Inde, il s'avère que les formalités de débarquement peuvent prendre plus d'une semaine, et que le seul port pouvant accueillir un bateau étranger est Cochin, sur la côte ouest, loin de la route de l'Ilboued. J'ai donc renoncé à l'Inde, déçue mais pas découragée. Après quelques échanges de courrier électronique entre Phuket et Rennes, nous avons fixé notre point de rencontre à Galle, au sud de l'île de Sri Lanka.
Antoine, mon plus jeune frère, s'est joint au projet au dernier moment, alors que l'Ilboued avait déjà quitté la Thaïlande.
Je me renseigne sur Sri Lanka - Ceylan. D'après ce que je lis, c'est comme un concentré de l'Inde du sud : mer et montagnes, thé et cuisine épicée. Je sens remonter en moi des souvenirs de l'époque ou avec JP nous vivions en Andhra Pradesh et partions en vacances dans les montagnes du sud de l'Inde. Cette période de notre vie a été notre découverte du monde, nous n'en sommes pas restés indemnes. Mais ce ne sont pas des souvenirs que je viens chercher maintenant...
Ce que je vais chercher à Sri Lanka, c'est Younn, mon fils.
Mais comment sera-t-il ? aura-t-il tant changé que nous aurons du mal à retrouver nos marques ? J'ai déjà oublié la sensation de le serrer dans mes bras. La surprise des retrouvailles durera-t-elle une minute, une heure, un jour ?
Sri Lanka (ancienne Ceylan) est une île en forme de goutte d'eau de 350 Km de long sur 180 Km de large. Les montagnes peuvent atteindre 2500 m d'altitude. L'économie du pays repose essentiellement sur la culture du thé, du caoutchouc et de la noix de coco, mais aussi sur le textile. Dès le Vè siècle av. J.-C., l'île a été envahie par des indiens du sud. Les rois cinghalais ont été les premiers à adopter le bouddhisme Theravada (du "Petit Véhicule") dès le IVè siècle avant J.-C. Ils construisent des capitales dans le centre de l'île et mettent en place des systèmes d'irrigation très importants avec des lacs et des barrages.
Les indiens du sud, de religion hindouiste, ont tenté à de nombreuses reprises de conquérir les capitales royales, sans succès, jusqu'au Xè siècle.
Après une période de déclin, les Portugais annexent l'île au XVIè siècle.
Puis ce sont les Hollandais qui occupent le pays. Ils établissent leur gouvernement à Galle, au milieu du XVIIè siècle.
Au début du XIXè siècle, les Anglais prennent possession de l'île. Ils font construire les routes et les voies ferrées. Les anglais développent la culture du café, puis du thé.
Ceylan obtient son indépendance en 1948, un an après l'Inde.
Les premiers gouvernements indépendants doivent gérer la rivalité entre anglophones chrétiens et cinghalais bouddhistes, puis entre Tamouls et Cinghalais. Après une période de nationalisations massives et de crise économique, les étudiants se révoltent en 1971. La répression est sévère, et la constitution est modifiée. Ceylan devient Sri Lanka.
La nouvelle constitution défavorise les Tamouls du nord, de langue et de religion minoritaires. Ils déclenchent des émeutes et réclament un état indépendant.
Sur le plan économique, le pays se redresse. La scolarisation se généralise, le tourisme se développe. Mais c'est l'escalade de la violence dans le nord du pays. Les "Tigres tamouls" attaquent des villages cinghalais, les cinghalais répliquent. Des dizaines de milliers de tamouls modérés quittent le pays. La violence s'étend à l'ensemble de l'île et le gouvernement doit investir des sommes gigantesques dans la défense. Actuellement, le nord et l'est du pays sont des zones interdites. Des attentats sporadiques peuvent se produire dans n'importe quelle ville de l'île. L'armée est partout.
Vingt heures vingt, heure française. Dans l'avion, il fait nuit. Il est une heure quinze à Colombo. J'ai besoin de me rassurer, j'explique à Antoine les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Comme si j'avais à me justifier. Inquiète et pourtant persuadée de n'avoir pas fait d'erreur. Antoine n'essaye pas de me rassurer :
- Je pense que si tu donnes le goût du voyage à tes enfants, tu en fais des frustrés.
Il me surprend par cette affirmation, lui qui a besoin de la mer en permanence, qui emmène ses enfants en bateau avant même qu'ils sachent marcher, qui ne prend pas les conventions au sérieux, qui s'habille toujours d'occasion... Comment peut-on avoir peur de l'avenir avec les cheveux en bataille et des airs de Woody Allen devenu moniteur de colo. J'essaye de trouver une répartie :
- Je ne veux pas en faire des frustrés, je veux les ouvrir au monde !
Non, je ne le convaincrais pas aujourd'hui. Le bonheur tranquille lui semble un objectif plus facile d'accès. Au moins, ainsi il n'y a pas de prise de risque... Mais pourquoi ai-je besoin de me rassurer maintenant ?
Nous arrivons à Colombo à cinq heures du matin. Un taxi nous mène à la gare des trains. Il faut traverser la ville dans une circulation infernale. Des militaires armés sont présents à tous les carrefours. Près des points stratégiques, des constructions de sacs de sable protègent des mitrailleuses. Impossible d'oublier que le pays est en guerre.
Le chauffeur nous montre un petit carnet qui pourrait s'appeler "livre d'or" s'il n'était aussi crasseux. Sur les trottoirs, des enfants sont encore endormis à même le sol. Le chauffeur est bavard. Il cherche les pages sur lesquelles il a collé des photos et des courriers d'européens ou d'américains contents de ses services. Dehors les klaxons et les moteurs font un bruit épouvantable. Nous passons auprès d'une décharge d'ordures, l'odeur est écoeurante. C'est encore le petit matin et la ville nous a réveillés sans aucune pitié. Je sens remonter en moi des souvenirs que je croyais avoir oubliés, des odeurs et des bruits qui me sont presque familiers. Je voudrais rentrer en moi-même pour mieux profiter de ces retrouvailles avec une certaine Asie...
Les bavardages du chauffeur continuent. La situation est assez surréaliste, et le taxi roule comme un fou vers la gare à travers des rues surpeuplées. La peur et la fatigue me font fermer les yeux quelques instants. La journée a commencé par un contact brutal avec le pays, elle va être longue et fatigante...
Nous n'avons pas envisagé une seconde, Antoine et moi, de voyager à l'européenne, avec un guide qui nous conduirait de lieu touristique en lieu touristique. Nous avons fait tacitement le choix de l'imprégnation maximale. Le chauffeur peut aller chercher d'autres clients !
A la gare, aucune difficulté pour avoir un billet pour le bon train sur le bon quai. Nous avons même pu manger un peu et boire du soda. Un énergumène (sympathique par ailleurs) vient discuter à notre table. Il veut nous rendre service et nous propose de venir dans sa famille, qui habite près de Galle. Nous comprenons rapidement qu'il essaye de nous louer une chambre d'hôte. Les Sri Lankais seraient-ils tous des rabatteurs ? Il nous laisse sa carte, mais nous n'en ferons rien.
Nous embarquons dans un train pour Galle. Il est bondé et nous sommes debout entre deux wagons, tassés les uns contre les autres dans le bruit et la chaleur. Quatre hommes sont debout sur le marchepied, accrochés aux poignées qui sont à l'extérieur du train. Ils tiennent ainsi, dehors, pendant plus d'une demi-heure en changeant de main de temps en temps. Nous ne sommes pas très à l'aise, plus ou moins assis sur nos sacs, dans le passage. Bien que nous ne soyons qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, le bruit rend tout dialogue impossible.
Alors que l'on s'éloigne de Colombo, le train se vide un peu à chaque gare, et nous arrivons à accéder à des places assises. Nous avons encore quelques heures de route avant Galle...
Pendant tout le trajet, la voie ferrée longe le rivage, parfois à quelques mètres seulement de la mer. C'est impressionnant de voir comment l'Océan Indien, en venant frôler les rails, les a par endroits presque ensablés. Des amas de blocs formant une digue entre la voie et la plage tentent de limiter les attaques de la mer, jusqu'au jour où une tempête emportera avec elle les rails et les traverses... Un aveugle circule dans le train en chantant. C'est un vieil homme voûté et sale, appuyé dur l'épaule d'une petite fille qui tient un gobelet pour l'aumône. Ils chantent dans une langue incompréhensible, une mélodie lancinante. La voix du vieux, grave et rocailleuse, mêne la chanson, et la voix aïgue de la fillette reprend, à la manière des kan-ha-diskan bretons. La chanson raconte probablement une histoire ancienne, une épopée de la mytholgie hindoue, interminable, lancinante...
Le voyage se passe ainsi, à regarder la mer, à s'étonner des attitudes des passagers et à s'habituer aux sonorités de la langue cinghalaise. Il n'y a ni fenêtres ni portes, ce qui provoque des courants d'air si bien que la température est tout à fait supportable. La crasse ambiante commence à imprégner nos vêtements et nos sacs à dos qui prennent une sympathique couleur locale.
Nous arrivons enfin à Galle, en plein soleil.
- Vous venez d'où ?
- Comment tu t'appelles ?
- Je peux appeler un tuc-tuc, je connais un très bon hôtel.
A peine sortis de la gare, nous sommes abordés par des bavards qui suivent nos pas en voulant nous conseiller (en anglais) pour un hôtel, un restaurant ou un tuc-tuc.
Antoine reste calme. Les sacs à dos sont lourds, il est temps qu'on le trouve, ce port, et qu'on pose nos sacs sur l'Ilboued.
- Vous cherchez un hôtel ?
- Où allez-vous ?
C'est trop. On est fatigués. Je m'énerve avec l'un d'eux qui ne veut pas nous lâcher. Il n'apprécie pas du tout de se faire rembarrer, et nous rétorque que si l'on n'aime pas les cinghalais, il ne fallait pas venir à Sri Lanka. Mes excuses n'y font rien. Il part fâché.
Nous sommes à une centaine de mètres de la mer et, comme si nous avions été attirés malgré nous, nous voilà sur une petite plage déserte, loin des bruits et des foules. Coup d'œil sur la baie. L'Ilboued est peut-être déjà là... Normalement, il devrait arriver demain mais on peut espérer que le dieu des vents lui a donné un petit coup de pouce...
Les épaules meurtries, nous laissons tomber nos sacs sur le sable. Personne autour de nous. La plage est bordée d'arbres, on peut apercevoir un vieux quai en bois, mais aucun bateau dans notre champ de vision. Dans ce pays où tout nous est étranger, la présence de l'Ilboued serait d'un réconfort immense. J'aurais dû dire "dans ce pays où nous sommes étrangers"... Alors que nous cherchons des yeux l'improbable goélette, nous sommes abordés par un petit homme curieux.
- Can I help you, mister ?
- Are you french, madam ?
Il est d'un abord plutôt sympathique et assez familier, moins agressif que les autres. Il est mince et nerveux, et ne doit pas peser plus de 40 kilos. Il me fait penser à Shankar, avec qui je travaillais en Inde. Il était mon interprète lorsque nous partions faire des enquêtes villageoises. Il était plein de bonnes intentions, malin comme un singe et très efficace. Il portait des pantalons gris ou marrons, avec un pli toujours impeccable, et des chemises en nylon imprimé à grand col ; cela lui donnait de l'importance. Dans ma tête, le petit cinghalais qui vient de nous aborder sur la plage s'appelle déjà Shankar et c'est le nom que je lui donne.
Il nous explique que les quais visibles à proximité sont les restes de l'ancien port, qui n'est plus utilisé. Un nouveau port a été construit de l'autre côté de la baie. Il nous dit qu'il y travaille et qu'il pourra nous aider à avoir des informations sur l'Ilboued. Sans hésiter, nous décidons d'y aller tout de suite avec nos bagages. Nous sommes impatients... Shankar appelle un de ses copains chauffeur de tuc-tuc, Sami. Et nous voilà partis voir ce qui se passe du côté du port de plaisance. Le voyage dure à peine dix minutes.
En fait de port de plaisance, c'est plutôt un port militaire. Il faut montrer "patte blanche". Nous ne pouvons pas passer la porte d'entrée vaillament gardée. Des fois que des "tigres" tamouls auraient mis une bombe dans nos sacs !
- Quel bateau ?
- Ilboued
- Il n'est pas arrivé, et il n'est pas annoncé. il ne sera pas là avant deux jours.
- Peut-on aller voir le port ?
- C'est impossible, revenez demain.
Déception, abattement. Le site a l'aspect d'un terrain vague, et alors que nous rêvions d'un contact avec des plaisanciers, nous n'avons eu que cet accueil froid et arrogant.
Nous passons au bureau du port (le Club Windsor) expliquer notre cas. Ici, l'accueil est plus chaleureux. Les fonctionnaires sont affalés sous leurs ventilateurs, ils nous écoutent. C'est apparemment le bon endroit pour se renseigner lorsqu'il s'agit de bateaux de plaisance. Nous ressortons avec la carte du Club. Nous téléphonerons demain. Retour vers le fort. Après la traversée de la ville, le vieux quartier du fort nous semble être le meilleur refuge. Nous allons y chercher un hôtel. Les indications du lonely planet nous mènent à la pension Khalid, 106 Pedlar street. La maison est au sud du fort, du côté du large, à quelques mètres du rempart. La chambre est correcte : deux lits avec douche et wc pour 500 roupies. Nous signons pour une nuit, et nous réservons deux dîners.
Avant toute chose, poser nos sacs, prendre une douche, s'allonger quelques instants.
Je ne peux m'empêcher de penser aux paroles d'une chanson de Gérard Manset : "Chambres d'Asie, retournes-y quand-même...".
Avant de dîner, nous allons faire un tour dans le quartier. Le cadre est magnifique. Nous sommes sur une presqu'île qui surveille la baie. Le site a été fortifié par les portugais au XVIè siècle. Vu de la mer, le fort doit apparaître austère avec ses grandes murailles plantées sur les rochers. Lorsque les vagues viennent s'y heurter, le bruit doit être impressionnant. Mais aujourd'hui, la mer est calme, comme un lac aux reflets verts.
Beaucoup de petits commerçants ambulants nous proposent des produits locaux : dentelles, petits éléphants d'ivoire et monnaies anciennes. Les touristes ne sont pas très nombreux. Le quartier du fort est isolé du reste de la ville. Ici, le tumulte des rues est remplacé par le clapotis des vagues et par le chant des corbeaux. Nous sommes ravis d'avoir élu domicile dans ce quartier.
Le dîner n'est pas à la hauteur de nos attentes. Sans doute à cause de la fatigue, et aussi des épices. Le riz semble avoir un goût de moisi... Dans le guide il est écrit : "le riz bon marché a souvent un goût de vieux, de moisi, et n'a rien à voir avec le riz thaïlandais". Je ne sais pas si ce riz est bon marché, mais il en a le goût. Madame Khalid, la patronne, est très discrète, voire même austère dans sa robe et son foulard de musulmane. Quand elle se déplace en faisant glisser ses pantoufles sur les dalles de sa grande maison, elle a un balancement de pingouin. Nous pouvions espérer que, faute d'être aimable, elle était au moins une bonne cuisinière...
Je m'allonge, déçue. Le sommeil vient vite. La journée a été longue, nous n'avons pas dormi depuis un quart de tour du monde.
Notre première nuit se passe très bien. Les moustiques n'ont pas été très agressifs et la chaleur était supportable. Nous prenons un petit déjeuner dans un café sur la place du fort : premier contact avec les en-cas épicés et les pâtisseries rances... Pas terrible. Le thé est bon, un peu trop sucré, servi avec du lait, à l'indienne. Nous avons dans l'idée que ce voyage n'aura pas un grand intérêt gastronomique...
Pour aller de l'hôtel à la porte de la ville, nous devons traverser tout le fort. Les ruelles sont étroites, les maisons rustiques ont été construites par les hollandais. Des casernements animent quelque peu le fort, et on peut voir des cavaliers passer dans les rues ou sous les arbres de la grande place. Des vaches broutent l'herbe dans la ville. A mon grand étonnement, elles ressemblent plus à des laitières normandes qu'à des buffles indiens. Elles ne sont pas attachées, mais surveillées de près par des garçons vachers. Des signes de reconnaissance ont été marquées au fer rouge sur leurs fesses. Elles sont comme chez elles sur la grand place, et aussi sur les remparts, où les étendues d'herbe verte ne manquent pas.
Les portugais, dès le XVIè siècle, venaient dans ces parages acheter des épices et de la cannelle pour l'Europe. Ils essayaient de convertir les populations au christianisme. Les hollandais les ont chassés un siècle plus tard, et ont fait de Galle un grand port de commerce. Le fort est aujourd'hui classé au patrimoine de l'UNESCO. Et voilà comment un bout de notre passé européen est définitivement figé à l'autre bout du monde...
En allant vers la ville, nous sommes comme attirés par la petite plage d'où l'on voit l'entrée du port. Sait-on jamais, si l'Ilboued arrivait, Nous le verrions pénétrer dans la baie... C'est le lieu des pêcheurs. Ils discutent en préparant leur matériel. Leurs canots à moteur sont au sec sur le sable, bord à bord, le nez tourné vers la ville. Sur le haut de la plage, des hommes réparent leurs filets. Ils se laissent prendre en photo en souriant, peut-être un peu moqueurs, mais peu importe. Leur bonne humeur nous réjouit. Ils nous demandent gentiment des cigarettes. Antoine n'a que du tabac et du papier, alors que manifestement, ils espéraient des américaines. Il leur montre comment il roule le tabac entre ses doigts... Les trois ou quatre pêcheurs ressemblés autour d'Antoine sont subjugués par son habileté et veulent absolument goûter à la cigarette qu'il vient de fabriquer devant leurs yeux. Peut-être soupçonnent-ils la présence d'une quelconque herbe mêlée au tabac... Ils se la passent en aspirant une bouffée chacun, et semblent apprécier. Mais ce n'est sans doute qu'une aimable politesse ; ils n'en redemandent pas. Toujours de bonne humeur, ils nous invitent à rester un moment. Nous ne nous attardons pas, il faut aller au port, celui où est peut-être l'Ilboued... Nous reviendrons.
Arrivés au port, on s'adresse au Club Winsor : pas d'Ilboued. Les officers nous assurent que le bateau n'arrivera pas avant deux jours. Je me demande d'où ils tiennent cette information... Je laisse une carte de l'hôtel et un message pour Bruno, au cas où.
Nous trouvons sans hésitation un but de promenade : la plage la plus proche, Unawatuna, à cinq kilomètres vers l'est. Le tuc-tuc nous y conduit.
C'est un paysage de carte postale : l'eau est turquoise et les cocotiers penchent vers le sable jaune en distribuant leur ombre si agréable. Le bain et le farniente nous font beaucoup de bien. Je déguste quelques instants le plaisir de n'avoir rien à faire. J'alterne entre le bain d'eau et le bain de sable, les yeux tournés vers la mer.
Au large de la plage, un cargo est échoué contre des rochers. A vue de nez, il est à environ 200 mètres du rivage. La coque paraît immense ; elle est comme posée sur l'eau, et on dirait qu'elle attend la marée haute pour repartir. Il s'en dégage une impression étrange, comme si elle était là pour nous rappeler que la mer a parfois des excès de fureur face auxquels même les plus grands navires ne peuvent que se soumettre. Cela me laisse songeuse... Et toutes ces histoires de navires que les femmes attendent sur le rivage pendant des jours et des jours, et qui n'arriveront plus jamais... Je pense à une chanson de Soldat Louis :
"Ombres courbées sous l'orage
ombres du vent
lassées des outrages de l'océan...
portées par d'autres images
ou d'autres temps...
elles attendent qu'ils viennent
elles attendent en vain..."
Mais c'est idiot. L'Ilboued a quitté la Malaisie il y a une vingtaine de jours, ils n'ont aucun moyen de nous contacter, il n'y a pas de raison qu'il leur soit arrivé quelquechose. Avant de partir, n'étais-je pas la première à rassurer les autres en disant bien haut :
- Si on a des nouvelles, c'est qu'ils ont lâché la balise argos. Et alors, c'est qu'il y a un gros problème...
Surtout ne pas penser à tout ça.
Des jeunes se baignent bruyamment. Les filles portent des pagnes sombres noués au-dessus des seins, et qui les cachent jusqu'aux mollets. Elles ont des allures de sirènes avec le tissus mouillé qui leur colle à la peau et brille comme des écailles, et pourtant cette tenue les empêche de nager. Les garçons, eux, se baignent en caleçon. Pas de maillots de bain pour les cinghalais. Ces jeunes-là jouent au ballon dans l'eau, s'éclaboussent et rient aux éclats dans une langue que l'on ne comprend pas.
Contraste : quelques blancs presque nus sont étendus sur des transats de bois. Ils somnolent ou ils lisent, ils sont souvent en couples, ils se baignent un peu.
La plage est belle, elle forme une baie bien abritée limitée à droite par un promontoire sur lequel on peut voir un dagoba, comme une grande cloche blanche.
Par prudence, nous sommes venus sans papiers et avec très peu d'argent. Résultat, nous ne pouvons pas payer intégralement notre repas (340 Rs). Le patron du restaurant nous propose de revenir payer plus tard. Cette attitude nous étonne, elle est contraire à ce que l'on peut lire dans les guides touristiques. C'est tant mieux. Nous trouvons cela fort sympathique. Nous reviendrons demain.
Retour en bus. Bonne opération : il y a des places assises, c'est beaucoup plus économique que le tuc-tuc, c'est rapide. La gare routière est à 300 mètres de l'entrée du fort, nous terminons à pied jusqu'à l'hôtel.
Shankar est là. Il nous annonce que le bateau n'est pas encore arrivé. Il nous propose de nous accompagner jusqu'au magasin gouvernemental d'artisanat. Il connaît un raccourci. Son attitude ressemble à du racolage, mais il nous est plutôt sympathique, et j'ai promis aux filles de leur rapporter des bagues... Après tout, faire des achats dans le magasin gouvernemental est plutôt une bonne idée. Il y a certainement moins de risque de roublardise qu'ailleurs. C'est aussi une occasion de ne pas rester seuls, et de pénétrer dans le quartier nord de Galle qui nous est inconnu.
Shankar pousse son vélo à la main et nous entraîne vers la gare. D'après nos renseignements, le magasin en question est derrière l'église, sur le flanc de la colline, dans un quartier très boisé et apparemment résidentiel. nous marchons donc ensemble, le long du canal, puis nous quittons la route goudronnée pour prendre un raccourci. Un sentier nous mène à travers un terrain en friches jusqu'à la voie ferrée. L'herbe est haute. Pourvu qu'il n'y ait pas de serpent ! Nous portons le vélo pour passer les deux voies. J'échange avec Antoine des regards qui en disent long sur notre inquiétude. Où nous mène-t-il ? Il faut maintenant aller jusqu'au bout. Nous sommes sur nos gardes.
Après un quart d'heure de marche, nous voilà devant une construction de béton à l'allure austère, entourée de grands arbres sombres. C'est ici que se trouvent le "bureau du tourisme de Ceylan" et la "corporation nationale des pierres précieuses".
Nous sommes accueillis par un homme mince aux cheveux blancs à qui il est difficile de donner un âge (60, peut-être 80 ans). Il nous commente la visite des ateliers : taille de pierres précieuses, fabrication de bijoux en argent, batik, bijouterie. Je suis captivée par le travail des hommes qui taillent les pierres et les polissent sur des meules verticales actionnées par un système de courroie et d'archet. Ceux qui fabriquent les montures des bijoux et qui incrustent les pierres sont assis autour d'une grande table, chacun devant lui dispose d'un petit appareillage de bois et d'outils sommaires pour poncer, lisser, graver... Ils ont les vêtements et les mains chargés de poussière d'argent. Je n'ose pas les photographier, j'ai le sentiment que déjà les regarder, c'est voler un peu de leur art. Sentiment sans doute ridicule, mais j'ai l'impression d'être dans un lieu sacré, tant la concentration est forte. Chacun s'affaire sur son petit chef d'œuvre de pierre et d'argent. Instant de magie que je garderai longtemps en mémoire.
Au premier étage, dans une grande salle assez obscure bien que partiellement ouverte sur le côté boisé de la ville, des femmes travaillent le tissus. Certaines, assises sur des chaises font des dentelles comme les femmes bretonnes de chez nous : devant elles, leurs ouvrages sont épinglés sur un coussin, et le réseau de fils blancs, chacun terminé par une bobine de bois qui pèse sur le fil pour le tendre, s'agite aux mouvements rapides de leurs mains. D'autres femmes dessinent sur des tissus colorés. Nous voyons mal ce qu'elles font, mais il s'agit visiblement de batik. Des toiles peintes sèchent à coté d'elles sur des montants de bois. Certaines filles doivent avoir à peine 12 ou 14 ans. Le guide nous débite son commentaire sur chaque activité à un rythme trop rapide pour que nous puissions bien comprendre. Nous aurions aimé nous attarder un peu, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres visiteurs.
Nous redescendons vers le magasin, en passant devant des vitrines de pierres précieuses qui nous sont décrites : corindon (saphirs et rubis), œil-de-chat, aigue-marine, zicron, améthiste, et surtout, dans la région de Galle, la pierre de lune, qui est une variété de feldspath réputée pour ses reflets argentés. A Sri Lanka, les pierres sont récoltées traditionnellement : les filons, présents dans les basses terres, sont exploités au moyen de puits. Ce sont des strates de graviers et de boue appelées illama. Les pierres en sont extraites après tamisage.
Je tiens la promesse faite à Marie et à Anne : une jolie bague pour chacune. Les pierres les plus foncées sont les plus chères ; il faut reconnaître qu'effectivement ce sont aussi les plus jolies. Sans doute une question d'éclat... Les prix ne sont pas beaucoup plus intéressants qu'en France. Shankar m'a dit tout à l'heure que c'était le moment d'acheter. Les taxes gouvernementales sur les pierres précieuses doivent passer à 30% la semaine prochaine. Ce n'est peut-être qu'un bon argument de vente, mais comment savoir ? Ni Antoine ni moi n'avons d'autre information sur ce sujet et il nous est impossible d'en savoir plus. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cinghalais a sans doute un intérêt à nous voir consommer dans son pays. On n'échappe pas à l'équation touriste = consommateur.
Shankar, qui nous avait attendus à l'extérieur, nous demande un service. Il s'agit d'un de ses amis, négociant en pierres précieuses, qui, sachant que nous sommes français, voudrait nous faire traduire un petit texte. Il nous est difficile de refuser. Allons-y, c'est l'occasion de faire connaissance avec un négociant chez qui on ne se présente pas en acheteurs. Tombons-nous dans un piège les yeux fermés ?
Les guides touristiques abondent de témoignages de voyageurs naïfs embringués dans des mauvais trafics de pierres à peine précieuses, et je suis très méfiante. Je pense savoir de quoi sont capables ces commerçants sans scrupules. Mais je connais bien Antoine, et je sais qu'il ne se laissera pas tenter par le business, ni par les dépenses inconsidérées. Ce n'est pas lui qui pourrait nous entraîner dans une quelconque entreprise commerciale. J'y pense en embarquant dans le tuc-tuc conduit par Sami. Shankar est avec nous et nous roulons à travers les petites rues animées et bruyantes. Les habitations sont cachées par des arbres et des arbustes mais je les imagine à travers les feuillages, sans doute assez sommaires. Il n'y a pas de trottoirs mais beaucoup de piétons, qui se réfugient sur les bas côtés lorsqu'un véhicule motorisé arrive bruyamment. Après un trajet rapide et tortueux, nous arrivons à la maison de ce fameux négociant. Nous pénétrons dans l'allée ; nous sommes attendus, presque comme des amis de la famille.
- C'est une demeure de la "Dutch périod" nous dit le maître de maison.
C'est donc une construction hollandaise, du XVIIè siècle (je pense soudain à Kerulvé, la maison de nos parents, construite à Lorient à la même époque). Cette grande maison a vraiment une allure coloniale. L'homme qui nous reçoit est assez âgé ; les poils blancs de sa barbe mal rasée contrastent avec la noirceur de son visage. Il nous montre ses richesses : canapés en bois de style hollandais recouverts de plastique transparent, comme si ils étaient là seulement pour être vus, et surtout pas pour servir. Les meubles encombrent la pièce et sont couverts de bibelots. Des vitrines sont remplies de fragments de faïence chinoise, de services à thé, de vieilleries et de photos d'enfants bien habillés dont la peau paraît trop blanche sous l'effet des flashs. Parmi cette profusion d'objets qui témoigne de l'aisance du propriétaire, je remarque dans une des vitrines une bouteille de Grants intacte. Notre hôte est certainement musulman. La bouteille est emmaillotée dans un filet de protection identique à celui qui entoure la bouteille de rhum que nous avons achetée à l'aéroport pour l'équipage de l'Ilboued...
Notre passons dans son bureau. C'est une toute petite pièce. Il a tout juste la place pour se tenir entre la table encombrée de papiers et le meuble vitré qui est derrière le vieil homme. Bien calé dans son fauteuil, il nous explique calmement qu'il est propriétaire de mines de pierre, qu'il emploie plusieurs tailleurs et polisseurs, et qu'il va ouvrir une succursale à kandy. Il nous demande de traduire les quelques mots de l'enseigne qu'il prévoit de mettre sur son nouveau magasin. Il sort lentement de son tiroir un petit papier sur lequel il écrit consciencieusement en lettres majuscules des mots parlant de pierres précieuses et de commerce. Je me rappelle à cet instant que les indiens aussi écrivaient toujours notre alphabet en lettres majuscules. La traduction ne me pose pas de gros problème, mais je fais bien attention à vérifier dans mon petit dictionnaire les mots pour lesquels je crains de ne pas être exacte.
Il nous offre un thé, et pendant que nous le savourons (il est vraiment bon), il nous propose des bijoux et des pierres à revendre en France. Nous y voilà. Nous sommes campés sur une position catégoriquement négative et il n'insiste pas. Il nous donne un calendrier des "pierres de chance" : à chaque mois correspond une pierre. Puis il nous donne une curieuse leçon d'hygiène corporelle :
Il est doctor en pierres précieuses (J'apprécie la manière avec laquelle il se sert de l'ambiguïté de ce mot qui peut vouloir dire tantôt expert et tantôt médecin). Chacun a pour pierre de chance celle de son mois de naissance. Il ne s'agit pas d'un porte-bonheur, mais d'un gage de bonne santé.
- Chaque soir j'immerge ma pierre dans un verre d'eau, puis je vais me coucher. Le matin à mon réveil, je sors la pierre du verre et je bois l'eau dans laquelle elle a baigné pendant la nuit. C'est une très bonne méthode pour être en bonne santé. Il faut que vous fassiez la même chose chaque jour.
Il lit notre scepticisme, sur nos visages, et il en rajoute :
- Je vous assure, tous les habitants de Sri Lanka y croient, c'est infaillible.
Cette discussion nous met mal à l'aise. Visiblement, il voudrait qu'on manifeste un peu de compréhension avant d'aller plus loin. Alors je lui annonce avec beaucoup d'assurance :
- Cette médecine-là ne pourrait pas marcher en dans notre pays, puisque aucun français n'y croit.
Honnêtement, je ne pense pas l'avoir convaincu mais il a au moins compris qu'il ne tirerait rien de nous. Il n'insiste pas, et nous donne à chacun une petite pierre de lune, en nous remerciant encore. Nous sommes étonnés de nous en tirer à si bon compte.
Après coup, on s'amuse de cette affaire. Je suppose qu'il doit aussi s'amuser de nous. Chacun a bien joué son rôle, personne n'a perdu, et chacun a gagné une bonne histoire à raconter.
En rentrant, nous passons voir les pêcheurs qui se préparent à partir en pêche avec la nuit. Ils proposent à Antoine de l'embarquer pour un retour à huit heures du matin. Il n a pas très envie de passer une douzaine d'heures sur un canot, à la lueur d'une torche à pétrole... Il refuse donc, et nous allons sur le rempart regarder le soleil se coucher et scruter l'horizon. Nous avons vraiment du plaisir à profiter du calme de ce lieu et même si nous savons bien que les chances sont très maigres, nous espérons assister en direct à l'entrée de l'Ilboued dans la baie de Galle. Il y a des moments magiques comme celui-là où l'on se prend à imaginer qu'il suffit d'y croire très fort pour que l'improbable se réalise. Et je me mets à chanter une chanson de Lorient : "En regardant de vers la mer jolie, en regardant de vers la mer, elles ont vu trois navires lon la...".
Rien ne se passe. Le ciel s'assombrit progressivement, et les chances de reconnaître un bateau sur la mer s'amenuisent.
Dès que la nuit est bien noire, des dizaines de petites lumières jaunes apparaissent progressivement comme des étoiles posées sur la mer. Nous cherchons l'Ilboued et il me semble le voir dès qu'une lumière est moins jaune que les autres. Mais comment le reconnaître ?
- Antoine, est-ce qu'il a des feux en haut des deux mats, l'Ilboued ?
- Sans doute que non, mais il en a au moins un qui est rouge à bâbord, vert à tribord, et blanc vers l'arrière.
- On doit pouvoir le reconnaître, alors.
- Oui, mais il faut se méfier. La nuit, à cette distance, je ne parierais rien. Je me suis trop souvent trompé. Laisse tomber, il est peut-être en train de passer sous nos yeux sans qu'on le voie.
Antoine a sans doute raison, et il l'on ne voit aucune lumière rouge ni verte. C'est comme un jeu pour nous de regarder toutes ces petites lueurs qui vacillent, tantôt jaunes, tantôt oranges, ou tantôt blanches. Je repère les bateaux qui bougent, et ceux qui sont immobiles, sans doute en train de remonter les filets. Nous sommes comme fascinés et nous parlons de ce que nous voyons. Nous attendons aussi en silence. Nous cherchons sur l'eau quelque chose qui serait pour nous. Une animation particulière due à l'arrivée d'un grand bateau gris par exemple. Mais rien. Je me lasse la première, et nous rentrons à l'hôtel. Nous sommes près de l'équateur et ici la nuit tombe vers 18 heures 30. La soirée ne fait que commencer.
Nous passons à l'hôtel prendre une douche bien méritée puis nous allons vers le centre ville pour faire connaissance avec les rues commerçantes. Ici, pas question de lèche vitrines, il n'y en a pratiquement pas. Mais l'animation est partout. Entre les bousculades et le bruit, nous approchons du marché, repérable à son affreuse odeur de pourriture. Les égouts et les poubelles sont à l'air libre, il est difficile d'en faire abstraction. Je recherche un magasin de saris indiens. Beaucoup de femmes sont en sari, et il doit être possible d'en acheter ici. On nous indique l'endroit, et me voilà plongée dans une ambiance indienne. C'est un petit magasin aux étagères chargées de tissus multicolores. Je fais déballer plusieurs beaux saris de soie brodés de fil d'or. Celui que je choisis est violet, Marie devrait aimer. J'achète aussi un madras bleu et vert. Les prix sont indiqués sur les tissus, si bien que je n'essaye pas de marchander, ça n'a pas l'air d'être le genre de la maison.
A peine sortis du magasin, des hommes nous abordent pour nous proposer des marchandises ou des adresses de commerçants. L'un d'entre eux, jeune et énergique, connaît quelques mots de français et engage la conversation. On lui demande de nous indiquer le restaurant "l'Empire", qui nous a été recommandé par Shankar, et il est ravi de nous conduire - à pied - à travers les rues. Il sait quelques mots de français et nous voilà tous les trois chantant "la pêche aux moules" dans les rues de Galle. La situation nous amuse beaucoup. Il nous raconte qu'il a appris notre langue grâce à des cours particuliers que lui ont payés ses parents. Maintenant il a presque tout oublié, mais il est content de pouvoir parler avec nous. Et nous le suivons, curieux de voir s'il ne va pas nous entraîner chez un négociant en pierres précieuses. Arrivés devant l'Empire, il n'a pas de mal à nous convaincre que ce restaurant n'est pas assez bien pour nous, et nous conduit ailleurs. Cela nous est complètement égal. Nous arrivons dans le quartier de la gare, et entrons dans le restaurant qu'il a sélectionné pour nous. Là, notre surprise est grande : On se croirait dans une cantine bruyante, obscure et sale. Au menu : cuisses de poulet grillées pas fameuses, sans doute pas très fraîches.
Contrairement à la nourriture, la conversation avec celui qui nous amenés ici est très agréable. Il veut être notre ami et nous faisons les présentations. Il s'appelle Kaï. Il nous parle de son pays, puis il tente de nous apprendre des mots du vocabulaire sri-lankais :
- Ou, yes
- Naa, no
- Hary honday, okay
- Iee, tea
- Eka, deka, una, atara... , one, two, three, four...
La prononciation est évidemment difficile pour nous, d'autant plus que notre professeur ne sait pas écrire en caractères européens. Le cours de langue cinghalaise ne dure pas très longtemps ; Je note des expressions sur une feuille que je conserverai précieusement jusqu'à la fin du séjour.
Kaï attache beaucoup d'importance à montrer qu'il est notre ami, et il ne veut pas qu'on paye le thé qu'il a bu en nous regardant dîner. Il nous serre chaleureusement les mains au moment de nous séparer et, curieusement, il demande à Antoine une pièce de monnaie française "en souvenir de nous". Antoine lui donne une pièce de deux francs mais cela ne lui plaît pas. Son amitié vaut plus cher que cela. Il réclame une pièce de dix francs. Antoine ne cède pas, et voilà notre ami d'un soir qui s'en va fâché. Nous ne le verrons plus.
J'ai le sentiment que la gentillesse de Kaï n'était pas complètement désintéressée. Mais peut-on lui en vouloir ? L'attitude d'Antoine me déconcerte. D'habitude, dans ce genre de situation, je suis avec JP, qui a tendance à être plutôt généreux. Je fais remarquer à Antoine qu'une pièce de 10 francs, pour nous, c'est juste de quoi aller boire un coup, et qu'en France, un gars qui nous aurait guidé et tenu compagnie comme Kaï vient de le faire, on lui aurait payé un coup. D'un autre côté, je comprends qu'on puisse en avoir marre d'être pris pour des donateurs sans limites, comme si notre argent nous venait du ciel. C'est un sujet de conversation compliqué, on est fatigués, aucun de nous deux n'a envie d'en parler plus longtemps.
Ce matin, petit déjeuner royal à la bakery du fort. Le thé est bon. Nous mangeons des brioches appelées ici des buns. Elles sont fabriquées sur place, fraîches et moelleuses, un vrai plaisir... Les plafonds sont hauts et clairs. La pièce est spacieuse et appartient à un bâtiment de l'époque hollandaise. Un moment de calme et de plaisir que nous apprécions et que nous faisons durer. Je ne sais pas combien de temps nous restons là, mais c'est bon.
Nous repartons à la plage d'Unawatuna pour payer notre repas de la veille. Sur la plage, nous faisons le découverte d'un autre restaurant sympa sur la plage : le "Hot-Rock". Les tables sont sur le sable, à quelques mètres seulement de pirogues traditionnelles en bois cousu. C'est là qu'entre deux bains, nous achetons des batik et des petits éléphants en bois peint à des marchands ambulants. Marchandage remarquable d'Antoine :
- How much ?
- 200 roupies
- too much ! 50 roupies
- 100 roupies
- too much !
Finalement, il a eu les trois pour deux cent roupies, ce qui fait environ sept francs pièce. Antoine est content de cette bonne affaire, et moi aussi puisque je lui rachète un éléphant pour Anne. Le nom du restaurant nous amuse et nous paraît très à propos : "Hot-rock" ou "Au troc" ? Nous jouons à prononcer l'anglais en roulant les "r", à la manière cinghalaise.
L'épave est toujours là devant la plage. Après une petite enquête, je sais maintenant qu'elle s'est échouée en novembre, lors d'un ouragan. Elle se transformera probablement en tas de rouille sur place.
Entre deux thés, et sans savoir encore qu'il y a des tortues dans la baie, nous prenons des bains à tour de rôle, afin que nos affaires ne soient jamais seules sur la plage réputée "à risques". Antoine et moi, nous ne buvons pas de bière. J’aime le thé " normal ", c’est à dire avec du lait et beaucoup de sucre ; Antoine préfère le plain tea, nature. Il faut dire que le thé est généralement très foncé, et fort en goût. Il est servi dans des verres épais, c'est difficile de le boire sans se brûler les doigts. Un thé coûte 10 roupies alors qu'une bière coûte environ 80 roupies.
Au retour, nous croisons un défilé d'écoliers que nous suivons jusqu'à un petit temple devant lequel les enfants font des représentations : danse traditionnelle au rythme des tambours par des jeunes garçons, évocation des travaux des champs par des petites filles costumées. Quelques enfants déguisés en lapins blancs sont assez anachroniques dans cette ambiance très cinghalaise. Un cortège accompagne jusqu'à l'intérieur du temple un reliquaire porté par quatre hommes. Nous ne comprenons pas la langue, les sonorités sont étranges, la nuit tombe et il n'y a pas de lumières. Nous les laissons à leur fête et rentrons à Galle.
Après quatre jours passés ainsi, entre les promenades à pied ou en tuc-tuc, beaucoup de recoins de la ville de Galle nous sont familiers : la gare et sa boulangerie, le marché, le port, le fort avec ses deux cafés, ses boutiques à touristes, ses bijouteries. J'ai même trouvé l'épicerie dont parle Nicolas Bouvier dans son livre "Le poisson scorpion" :
Pour entrer, on écarte du front une frange de bonites séchées suspendues au linteau et qui sentent, j'en conviens, carrément le derrière. A l'intérieur, d'autres odeurs : cannelle, girofle, café frais moulu font oublier la première et c'est, de toute l'île, l'endroit où je me sens le mieux. Les murs sont tapissés de bidons poisseux et dorés, mélasse ou huile de palme. Le tabac à chiquer pend en lourdes tresses noires sur les pyramides d'oeufs conchiés par les mouches et les régimes de bananes accrochés aux murs bleus flamboient comme des lampions...
Sa vision de Galle est bien différente de la mienne. A chacun son voyage...
Chaque jour nous allons voir au port si L'Ilboued est là, et chaque soir nous scrutons la mer à la recherche de la silhouette familière. Les remparts me rappellent ceux de nos côtes bretonnes, avec les mêmes bastions qui surveillent l’arrivée de l’ennemi. Les pelouses ont remplacé les chemins de ronde et cela fait bien longtemps que les soldats ne sont plus intéressés par ces places maritimes entourées d’épaves. Les touristes qui passent à Galle font la promenade des remparts, c’est conseillé dans les guides. Ils ont raison, c'est l'endroit le plus agréable de la ville. Et encore, à condition de ne pas entendre les vendeuses de dentelles ni les vendeurs de pièces anciennes. Maintenant, Antoine et moi sommes suffisamment connus dans les lieux pour ne plus être importunés. Il y a bien un petit moustachu qui a remarqué mon intérêt pour les veilles pièces qu’il pêche dans les épaves autour du fort. Il vient me proposer chaque jour des prix plus intéressants. Mais je lui ai déjà acheté pour 400 roupies deux pièces hollandaises datées 1802 et "deux pièces royales d’avant les portugais".
Avant nos comptoirs, nos rapines, nos vaisseaux de haut bord qui ont fait ce port et cette ville, il n'y avait ici qu'une bourgade d'acrobatiques cueilleurs de noix de coco, de pêcheurs lancés dans le ciel par l'écume et de colporteurs de cannelle (Nicolas Bouvier)
Après avoir vécu toutes ces journées dans la sobriété, fatigués et un peu abattus de ne pas voir arriver le bateau, nous ouvrons une bouteille de rhum achetée à l'aéroport. Nous sommes chez des musulmans et l’interdiction d’alcool est rappelée par un écriteau sur la porte, comme un affront à la liberté individuelle. Dans notre chambre avec vue sur cour, se prépare alors une étrange mixture à base de jus d’orange concentré et d'eau. Ce breuvage nous fait un punch acceptable à la manière de Kerulvé. Cette évocation, ajoutée à notre complicité fraternelle dans cette aventure, nous réconforte plus encore que la boisson elle-même.
Nous prenons le petit déjeuner dans notre bakery préférée prés des remparts. Nous téléphonons une fois de plus au port : pas d'Ilboued. Les ressources touristiques de Galle s'épuisent. Il nous reste à voir le musée du fort, après quoi nous irons en excursion à Kogalla, à une quinzaine de kilomètres vers l'est.
Le musée du fort est aménagé dans l'ancien siège du gouvernement hollandais. Meubles et bric à brac d'intérêt inégal ; vue sur des orfèvres au travail. L'habileté avec laquelle ils font tourner le foret pour percer les bijoux d'or et d'argent me fait penser aux techniques primitives : le foret est activé par une poignée que l'orfèvre monte et descend et qui enroule et déroule deux cordes reliées à la drille. Le mouvement régulier fait tourner la pointe qui perce l'or avec une précision admirable. A la sortie, passage obligé par la boutique de vente de bijoux. J'achète deux chaînes anciennes, et je fais faire des boucles d'oreilles avec deux vieilles pièces de monnaie en argent. Total = 2350 Rs. Si je compte bien, cela fait juste un peu plus de 200 francs. Compte tenu du lieu, je ne m'en suis pas si mal tirée.
Billets en poche, il nous faut attendre le train, direction Koggala. Départ prévu à 2.30 pm. Nous allons dans un restaurant près de la gare. Comme il n'y a pas de climatisation, aucun rayon de soleil de doit entrer. L'ambiance est à la fraîcheur et à l'obscurité. Contraste agréable avec l'ambiance extérieure. Le curry est trop épicé pour nous, mais c'est tout de même ce que nous avons mangé de meilleur depuis notre arrivée à Galle. Nous sommes très satisfaits d'avoir trouvé cette bonne adresse tout seuls. Shankar et Sami ne sont pas apparus ce matin ; ils ne nous manquent vraiment pas.
Le train de troisième classe est en bois du sol au plafond, et à notre grande surprise, il y a peu de monde. Après un bon quart d'heure, nous arrivons à Kogalla où nous descendons pour entamer une marche à pied le long de la voie jusqu'au passage à niveau, 500m plus loin. C'est le seul accès, lorsqu'on n'a pas de voiture, pour visiter le "Martin Wickramasinghe Museum of Folk Art & Culture". Un riche cinghalais d'origine hollandaise a fait construire ce bâtiment dans son parc vers 1950 et y a accumulé toutes sortes d'objets traditionnels. Le musée est entouré d'un vrai gazon, et de très beaux arbres. Antoine a des problèmes de chaussures, et il prend plaisir à marcher pieds nus sur la douce moquette naturelle. Nous sommes presque seuls. Dans les vitrines, les masques anciens côtoient les ustensiles domestiques. Si l'entretien reste ce qu'il est, ce musée sera bientôt qu'un amas d'objets abîmés et poussiéreux. Déjà des étiquettes sont décollées, des bois déformés et racornis, quand ils ne sont pas mangés par les termites. Bref, un musée intéressant, mais en perdition. Dans le parc, une pirogue à balancier est posé sur une butte de sable. C'est un modèle sûrement ancien, mais encore utilisé. Nous avons vu les mêmes sur la plage d'Unawatuna. C'est étrange de la voir posée là, à cinq cent mètres de la plage. Le fondateur du musée pensait sans doute que ce type de bateaux serait bientôt abandonné... La vision de ce bateau de pêche au sec a fait dire à Antoine :
- Ils ont peut-être ici aussi un plan Melik !
C'est un plan de restriction des flottilles de pêche qui a entraîné la destruction de nombreux chalutiers, si bien qu'aujourd'hui, dans les villes côtières françaises, sur les ronds points ou dans nos jardins publics, on voit quelques vieux chalutiers échoués comme les oubliés d'un ancien déluge. Ce sont les frères de cette pirogue à balancier...
Assis sur un banc sous les arbres, nous oublions un instant que nous sommes deux errants dans une région du monde qui nous est complètement étrangère. Et nous voilà partis pour une ballade au bord de la mer, qui n'est qu'à dix minutes à pied. le ciel est gris, le vent souffle, et pourtant il fait chaud et le soleil perce à travers les nuages. Les effets de lumière sont fantastiques, l'eau est limpide et chaude, le sable se confond avec l'herbe sur le haut de la plage. Magnifiques harmonies de jaune, de gris, de vert.
Le retour à la gare nous fait traverser un village de pêcheurs dans lequel il n'y a pas la moindre buvette. Une charmante dame nous sert un thé dans une sorte de coin salon de ce qui semble être se propre maison. La conversation est difficile, nous ne comprenons pas grand chose. Après avoir régle notre consommation nous regagnons la gare. Une fillette nous montre le chemin entre les maisons et les arbres. Elle se laisse prendre en photo. Son sourire est celui d'un enfant heureux...
En rentrant de Koggala, nous quittons le train trois cent mètres avant le port et nous finissons à pied. La nuit commence à tomber. Si ils pouvaient être là... Au poste de police, ce n'est plus nécessaire d'expliquer ce que nous cherchons. Ils nous connaissent maintenant. Cela ne les empêche pas d'être toujours aussi peu aimables. Mais ce soir ils ont une bonne nouvelle pour nous : l'Ilboued est là ! Enfin, nous allons pouvoir monter à bord.
- Impossible, vous ne pouvez pas pénétrer dans l'enceinte du port, nous dit le policier avec autorité.
- Mais si le bateau est là ...
Rien à faire, nous ne pouvons pas passer la barrière d'entrée du port. Le port de Galle est bien gardé. Qu'abrite-t-il de si dangereux ? ou de si précieux ? D'où nous sommes, il est impossible de voir les quais ou les bateaux. Pas une grue, pas un mat.
Nous ne comprenons pas la raison de cette extrême protection, mais il semble être question de douane, de bureau fermé, d'absence du capitaine. Rien à faire. Nous laissons un nouveau message au Club Windsor : "vous pouvez nous contacter à l'hôtel, on ne bouge pas, on attend votre coup de fil", et les coordonnées de l'hôtel. Une seule chose à faire : rentrer maintenant à l'hôtel et attendre, encore.
Rangement de nos sacs. Difficile d'y faire entrer tous nos petits souvenirs. Le téléphone sonne. La patronne nous appelle. Très excitée, je prends le combiné :
- Allô ?
- Hello frangine, ça va ? On vous attend...
- Salut. Tu exagères, c'est nous qui vous attendons... On finit nos sacs et on arrive. Et comment va Younn ?
- Je te le passe, me répond t-il. Et j'entends la voix de Younn :
- Bonjour. C'est qui le mec avec toi ?
Le message que nous avons laissé au Club Windsor trahissait la présence d'une deuxième personne. Les navigateurs ne s'attendaient pas à me trouver avec un compagnon de voyage, et encore moins celui-là. Antoine n'avait jamais quitté l'Europe avant le début de la semaine.
Notre attente est terminée. Nous les avons retrouvés. C'est le bonheur... D'où vient ce soulagement ? Moi qui croyais pourtant ne pas être inquiète... Je dois bien reconnaître que le fait de savoir l'Ilboued au port et l'équipage en bonne forme a balayé toutes mes angoisses non avouées.
La nuit commence à tomber, et tandis que nous réglons la note de l'hôtel, Shankar arrive en vélo. Il est au courant pour l'arrivée du bateau. Il voulait sans doute nous prévenir que notre frère était arrivé, mais nous avons été plus rapide que lui... Il n'a pas eu ce plaisir. Il s'empresse d'aller nous chercher un tuc-tuc, puis c'est le départ vers le port avec notre chargement. Antoine se réjouit en pensant qu'au moins, en regagnant l'Ilboued, on se débarrasse de ce "guide-rabatteur" un peu encombrant. Nous quittons l'hôtel avec plaisir. Enfin, le moment de voir l'Ilboued et son équipage est proche.
Ce n'est pas facile de voir nos chers marins. Impossible de présenter nos papiers à la douane car les bureaux sont fermés à cette heure. Après quelques explications, et grâce aux précautions prises par le capitaine Bruno (y aurait-il du bakchich là-dessous ?) les militaires nous laissent finalement rejoindre l'équipage, qui dîne sur le quai. Enfin !
Younn est souriant. Un peu timide, ému, bonne mine et vareuse rose. Je suis si heureuse de le retrouver que je ne vois que lui. L'équipage compte trois personnes : Bruno, le capitaine, Susan, l'équipière anglaise, et Younn, le mousse. Il y a aussi la chienne : Singha, la Thaïlandaise.
Nous dînons d'une gambas géante accompagnée de bière. C'est royal. Le restaurant est temporaire, les cuisines sont dans une espèce de cagibi, et toutes les tables sont dehors. Il est installé ici le temps de l'escale d'un rallye américain à la voile : poste sécurité, radio, bureau de tourisme. Nous profitons de la situation, assis autour d'une table dans la douce chaleur du soir, au bord du quai et nous discutons en mangeant.
Bruno (beaucoup) et Susan (un peu) parlent de Michel Delavil qui a quitté le bord aujourd'hui au grand soulagement de tout l'équipage. La cohabitation a été difficile, et l'absent aurait, à l'unanimité, tous les torts... Il est vrai que la vie à quatre sur un voilier de 12 mètres n'est agréable que si chacun y met du sien. Ce n'était apparemment pas le cas de tout le monde. Le sujet est vite épuisé, Bruno, Susan et Younn ayant plus de plaisir à regarder vers l'avenir qu'à ressasser le passé. Seule une drôle d'expression codée se glissera de temps en temps dans nos conversations pour rire de l'anecdote : "espèce de SPTDC".
J'ai donné à Younn le sac de bonbons acheté Rennes ; il en était ravi et n'a pas voulu en manger tout de suite. Il a pris des nouvelles de tous, et m'a demandé si j'avais quelque chose de la part de sa classe. Ma réponse négative l'a beaucoup déçu.
Pour Antoine et moi, le coup est dur : nous ne pouvons pas rester,. Il nous est formellement interdit de monter à bord du bateau ce soir. Il faut retourner à terre pour la nuit et revenir demain pour les formalités. Alors seulement, lorsque le bureau de douane sera ouvert, nous pourrons être enregistrés comme membres de l'équipage, et nous pourrons embarquer.
Younn a fini par attaquer son paquet de bonbons. Il a la larme à l'œil...
Je n'ai pas sommeil. La chambre me paraît moche ce soir, avec sa petite fenêtre à barreaux qui donne sur la cour. Ils ont dû regagner le bateau. Peut-être ont-ils trouvé la bouteille de rhum qui était dans le sac d'Antoine, et y ont-ils goûté. Je me rends compte que je n'ai pas donné à Younn les lettres que j'ai pour lui de la part de ses soeurs et de JP.
Pendant la soirée, Bruno m'a demandé discrètement :
- Est-ce que Younn t'a dit qu'il était content ?
J'y réfléchis
Est-ce que nous sommes contents, chaque jour, de ce que nous faisons ? Il est à bord pour un voyage, il le fait. Je suis peut-être un peu dure, mais je crois avoir compris dans l'attitude de Younn et dans ses paroles qu'il a souffert du mal de mer, du travail, de la solitude. Malgré cela, il est toujours aussi décidé, et il a la volonté de continuer.
Bruno est inquiet quant aux études de Younn :
- A ce rythme là, il ne finira sans doute pas le programme.
- On en reparlera...
Je vais essayer de le faire travailler suffisamment pour résorber le retard. L'objectif est que je rapporte en France une série de devoirs pour le CNED.
Il m'a parlé de Singha qui n'a pas beaucoup grandi, de son départ déchirant d'avec Nick, de la possibilité pour JP de les rejoindre en Méditerranée...
- Il ne souffre pas trop de l'absence de son fils ?
Il n'est pas là pour répondre...
Tout l'équipage était content d'avoir touché la terre ferme, après deux semaines de mer depuis Phuket. Le capitaine et les marins avaient besoin d'être rassurés sur la personnalité de Paul, qui doit embarquer ici dans 10 jours. Antoine et moi, qui n'avions que très peu d'éléments sur ce sujet, avons tout fait pour les rassurer. Paul avait eu d'excellents contacts avec nos parents. Retrouvailles agréables donc, pendant lesquelles Antoine et Susan se sont tenus un peu à l'écart. Ou du moins, je l'ai senti comme ça. Mais il est vrai que je n'avais d'yeux que pour Younn et pour Bruno.
Demain matin, il faudra quitter l'hôtel à nouveau, passer à la banque, aller au port remplir les formalités... Et enfin, nous pourrons monter à bord.
Après deux jours passés sur le bateau, à se raconter chacun nos histoires, à vider nos sacs, à nettoyer la cabine, à faire des lessives et des courses, nous avons compris certaines choses :
Le port se présente comme une anse fermée par une longue digue. D'un côté la plage, avec ses barques de pêcheurs, puis le quai, auquel est amarré un ponton chargé d'une vingtaine de bateaux de plaisance, puis une longue digue qui ferme la baie. Une autre digue avance vers la mer à partir de la plage si bien que l'espace portuaire est relativement fermé et très vaste (L'anse du Stole à Lomener pourrait tenir dans cet espace). Derrière la plage, on voit la route qui mène à Unawatuna, et le quartier du marché. Le port abrite des bateaux militaires. C'est la raison des contrôles si sévères à l'entrée. La nuit, un canot chargé de soldats fait des rondes de surveillance dans le port. De temps en temps ils coupent le moteur, restent immobiles dans le noir, puis soudain, ils balayent le port avec un projecteur dont le faisceau éclaire tour à tour les moindres recoins. Lorsqu'il s'attarde sur l'Ilboued, il faut reconnaître que ce n'est guère rassurant. Bruno m'explique que leur objectif est de prévenir un éventuel attentat tamoul. Un câble ferme l'entrée du port, et des escorteurs (ou d'autres bâtiments de ce genre) contrôlent les bateaux qui croisent au large. Parfois, on entend des sourdes détonation, ce sont des bombes qui explosent sous l'eau, au cas ou des hommes-grenouilles indépendantistes tenteraient une intrusion...
L'Ilboued est mouillé près de la digue, à portée de fusil du mirador. Il est inutile de penser à une croisière sur les côtes de l'île... Tout bateau qui quitte ce port doit s'éloigner des côtes Cinghalaises.
Notre petite vie de faux couple est terminée. Antoine et moi avons changé de rythme de vie et de lieux de promenade, les membres de l'équipage aussi, d'une autre manière. Il faut s'approvisionner pour préparer les repas à bord. Nous savons maintenant où sont les magasins d'alimentation, de pain et de boissons alcoolisées. Les réserves de Mékong (alcool thaïlandais) sont épuisées et le "Old Arak" fait très bien l'affaire.
Je découvre Susan, qui me parle de la première partie du voyage, longue et monotone, au cours de laquelle elle a fait la connaissance des autres équipiers : Michel, dont on ne parle pas (ce "SPTDC"), Younn, et Bruno, dont on parle. Elle voudrait visiter l'île, moi aussi. Nous irons ensemble, respirer l'air frais des montagnes, visiter des vieux temples, et voir des plantations de thé.
Avec Younn, j'ai parlé de la famille et du collège. Il a peu de choses à raconter sur la traversée qu'il vient de vivre. Le bateau a fait escale à Langkawi (Malaisie) pour acheter de quoi remplir les cales de nourriture avant la grande traversée. Il a eu le mal de mer, il a dessiné, il a travaillé. Bruno l'a aidé pour ses maths, et Susan pour son anglais. Il a fait sa place à bord. Au-dessus de sa couchette il a collé les photos de ses soeurs et de ses parents, plus quelques images et bibelots qui ont de l'importance pour lui. Ses vêtements sont en vrac dans un caisson, ses affaires de travail sont mélangées dans un autre, avec la pharmacie du bord. Il a fallu plusieurs heures pour mettre en ordre ce joyeux bazar.
Chaque fois que l'un d'entre nous veut débarquer, il faut organiser le transport. Younn est capitaine de l'Ilbouedik (c'est le zodiak - annexe) et il manie le moteur avec une maîtrise presque totale, Singha à ses côtés. Le plus difficile est de rejoindre l'Ilboued lorsque l'annexe est au mouillage et que l'on est sur le quai. Deux solutions : la première, c'est l'appel radio à partir du Club Windsor (à trois cent mètres de là) :
- Ilboued, Ilboued...
- tut... tut...
- Ilboued, Ilboued...
- tut... tut...
Je n'ai jamais réussi à avoir quelqu'un à l'autre bout.
La deuxième solution, c'est d'attendre une autre annexe. Ca marche à tous les coups. Il y a souvent d'autres équipages prêts à rendre service, mais quelquefois il faut attendre longtemps.
L'Ilboued est entre deux voiliers français : à babord le Snoopy, et à tribord le Perceval. Les deux skippers s'appellent Guy. Ils font la "grande boucle" avec leurs femmes. Comme il n'y a qu'une seule bonne saison pour faire le retour vers l'Europe quand on vient de la Thaïlande, et qu'il n'y a pas tant d'escales possibles pour ce type de bateaux, ils se retrouvent souvent en même temps dans les mêmes ports. Cela crée une certaine complicité entre les équipages. C'est bizarre de penser que pour certains, la terre est comme une petite ville dans laquelle on croise des visages connus au hasard des escales...
Et comme si les gens de mer devaient vivre aussi les problèmes de voisinage habituellement réservés aux terriens, voilà ce qui se passe : pour recharger leurs batteries, Perceval et Snoopy doivent faire tourner leur groupe électrogène pendant une heure. L'Ilboued a une éolienne qui lui suffit. Chacun ses besoins, c'est d'accord. Mais si les deux voisins faisaient tourner leurs groupes ensemble, cela ne ferait qu'une heure de bruit par jour au lieu de deux. Et bien non. Rien à faire. C'est de 6 à 7 le matin sur Snoopy, et de 6 à 7 le soir sur Perceval. Les marins seraient-ils des hommes ordinaires ?
Deux jours de cette vie sédentaire, et nous voilà impatients de visiter l'intérieur de l'île. Notre choix est fait : en train jusqu'aux montagnes avec escale à Kandy, puis en voiture pour le retour en passant par une réserve naturelle puis en longeant la côte sud. Quatre jours devraient suffire. Bruno préfère rester à bord, au calme et avec Singha.
Avant de partir, nous trouvons le temps de visiter une mine d'extraction de pierres de lune, à une trentaine de kilomètres vers le Nord. Les puits d'extraction font au moins quarante mètres de profondeur et l'on distingue à peine les deux hommes qui sont au fond, de l'eau jusqu'à la taille. Des planches mal équarries étayent les parois, et semblent n'assurer qu'une sécurité très relative. En haut, trois hommes hissent à la manivelle les seaux chargés d'un mélange laiteux. Plus loin, cette boue est tamisée à la main dans une mare, et les pierres de lune sont mises de côté. Il faut reconnaître qu'avant polissage, elles n'ont aucun attrait particulier ; tout juste un reflet argenté.
Je suis déjà angoissée à l'idée que ces vacances vont se terminer dans moins de 10 jours. Il faut profiter à fond des moments que nous passons ensemble.
Nous voilà partis pour Kandy. La voie longe la mer et traverse des villages de pêcheurs. Certaines maisons sont installées si près de la voie que les habitants ne peuvent pas sortir si un train passe. On observe le long des rails des installations de cordeliers : les cordes de fibre de noix de coco sont tendues sur des piquets le long de la voie, sur de très longues distances, peut-être une centaine de mètres.
Changement de train à Colombo. Le voyage est pénible, nous sommes souvent debout, secoués, écrasés, dans la chaleur. Une panne en pleine campagne nous immobilise pendant deux heures en plein soleil. Les conditions ne sont pas mauvaises pour un peu de grammaire. Younn s'y met et boucle un devoir de plus.
Arrivés à Kandy, il est tard. Il faut chercher un hôtel. Susan est très efficace. Elle a souvent voyagé dans les pays tropicaux, elle a l'habitude des discussions à propos d'un hôtel ou d'un taxi. Sans elle, nous aurions certainement du mal à nous faire comprendre et à ne pas nous faire (trop) avoir. Nous trouvons des chambres d'hôte au "Freedom lodge". La famille est très accueillante et le nom de la maison nous inspire confiance. C'est bien, mais juste un peu loin du centre. Les chambres sont dans une aile ajoutée à la maison, indépendantes. Antoine et Younn sont en bas, Susan et moi à l'étage. Après l'indispensable douche, nous irons nous promener dans la ville et visiter le "temple de la dent".
Selon la légende, une dent de Boudha aurait été récupérée sur son bûcher funéraire, et apportée à Ceylan au IVè siècle. Elle aurait séjourné en Inde au XIIè siècle, puis serait revenue à Kandy ; les portugais l'emportèrent pour la brûler à GOA. On dit qu'ils ne brûlèrent qu'une réplique... Le temple a été construit à la fin du XVIIè siècle pour conserver et honorer cette relique. D'après le dessin que j'en ai vu, elle ressemble plus à une dent de cachalot qu' une dent humaine... C'est un haut lieu de pèlerinage, où se déroule une très importante cérémonie pendant la pleine lune de juillet-août.
Nous sommes justement un soir de pleine lune et les pèlerins sont nombreux. Les sacs sont contrôlés ; l'attentat tamoul est une angoisse permanente ici. Les visiteurs sont séparés en deux groupes : les pèlerins et les touristes. Les premiers ont accès aux salles de prière ; les seconds paient plus cher et n'ont pas accès à toutes les salles ; ils peuvent prendre des photos. Cette distinction traduit une bonne analyse de la situation : les touristes ne sont-ils pas là pour observer les pèlerins ?
A l'intérieur, dans la salle de la "dent", des musiciens jouent du tambour et d'une sorte de petite bombarde. La musique est lancinante, voire envoûtante. La relique est bien protégée par des coffres gigognes cachés derrière une porte d'argent. Les pèlerins font des offrandes puis attendent le moment où ils pourront accéder aux salles de prière. La vie de Bouddha et les péripéties de la dent sont peintes au plafond. Nous ne sommes pas les seuls touristes à observer avec curiosité l'architecture, les peintures et les gestes des pèlerins, tellement inhabituels pour nous.
Nous déambulons en ville à la tombée de la nuit, puis dînons dans un restaurant très décevant : cher, pas très bon, et télévision allumée en permanence.
La nuit aurait été bonne s'il n'y avait eu les aboiements des chiens. Mais le somptueux breakfast, avec fruits et toasts, nous réconcilie avec les lieux.
Le minicar est là comme convenu à 8 heures, et nous emmène pour une excursion vers les sites archéologiques de Dambulla, Sirigia, et Polonaruwa. Le chauffeur nous propose la visite d'un jardin d'épices mais nous refusons. La journée sera chargée, et nous ne pourrons pas tout voir !
Cent kilomètres vers le nord : Dambulla. Il faut monter sur un chemin aménagé dans le rocher pour atteindre les grottes décorées. Ce temple rupestre daterait du Ier siècle avant J.-C. Dans chacune des cinq grottes, les parois sont peintes et contiennent des bouddhas, dans différentes postures, taillés dans la pierre et peints. Les photos sont interdites, dommage, mais de toutes façons, la lumière est si faible... Au total, il y aurait 150 bouddhas, le plus grand atteignant 50 mètres de long et six mètres de haut. Certains plafonds sont magnifiquement décorés de petites images de scènes de la vie de bouddha, il n'y a plus un endroit où l'on peut voir le rocher naturel. Je ne me lasse pas de regarder toutes ces petites peintures en me tordant le cou, et ce n'est pas très confortable... Un office va commencer, les touristes sont priés de sortir.
A l'extérieur, la vue sur la plaine est magnifique. Younn a disparu. Est-il sorti de l'enceinte du temple ? Nous commençons la descente sans lui, il est un peu plus bas dans le chemin, avec des singes.
- Ils sont trop marrants !
Encore une centaine de kilomètres vers le nord-est et nous voilà à Polonaruwa. Ce fut la ville royale de Ceylan du Xè au XIIè siècle ; des fouilles archéologiques récentes ont permis de restaurer quelques édifices (palais, temples, et bibliothèques) dont il ne reste souvent que le bas des murs et quelques statues redressées. Nous explorons ce vaste champ de ruines en voiture, en faisant quelques haltes près des monuments spectaculaires. Les lieux ne sont pas très balisés et il est difficile de s'y retrouver. Cela manque de plans et de panneaux explicatifs, et notre chauffeur, malgré ses efforts, ne fait pas un très bon guide.
Nous prenons le temps de faire le tour d'un immense dagoba, le Rankot Vihara, qui se dresse à 55 mètres de hauteur. Comme tous les dagoba, il contient une un objet ayant appartenu à Bouddha ou un de ses os qui aurait résisté à l'incinération. Il faut imaginer la foule des pèlerins dans leur marche circulaire autour de cet immense dôme, s'arrêtant à chaque petit autel (aux quatre points cardinaux) et y déposant des fleurs, allumant des lampes d'argile, brûlant de l'encens et récitant des formules.
Sur certains bâtiments, des frises sculptées représentent des nains dans les positions les plus diverses. Un air nous trotte dans la tête : "donne-moi ta nain, et prends la naine... Gernaine" ; Younn chante souvent cette chanson de Sttellla, qu'il a sur une cassette à bord de l'Ilboued. Nous rions des attitudes des petits nains sculptés, ce qui ne nous empêche pas d'apprécier l'harmonie qui s'en dégage. Les thèmes représentés ici sont les feuillages, les animaux les nains comiques et les bouddhas. Rien à voir avec l'art religieux de chez nous où, à l'époque de la grandeur de Polonaruwa, se bâtissaient nos cathédrales.
Au pied des escaliers des temples, les pierres de seuil ont la forme d'un demi disque et sont ornées de frises concentriques. Bien qu'elles n'aient aucun rapport avec les pierres précieuses, on les appelle aussi des "pierres de lune".
Sur une pierre de lune, tout le décor est symbolique. Ainsi l'accès au sanctuaire représente les étapes successives que le fidèle doit parcourir pour arriver à la connaissance :
- les flammes du désir (les langues de feu).
- la naissance (l'éléphant),
- la vieillesse (le taureau),
- la maladie (le lion),
- la mort (le cheval),
- le désir (les volutes de feuilles et de fleurs).
- le discernement, l'aptitude à séparer le bien du mal (l'oie). La légende veut que ce volatile soit capable de boire le lait d'un mélange d'eau et de lait sans absorber une seule goutte d'eau.
- le désir maîtrisé (les nénuphars). Ces fleurs fleurissent en naissant de la vase.
- enfin, la position solidement établie au milieu des possibilités de l'existence (le lotus).
L'impétuosité du cortège des animaux, les lignes sinueuses des plantes et des langues de feu, tous ces éléments concourent à donner l'image du tourbillon incessant des désirs dont le bouddhiste doit s'affranchir.
Le grand Boudha couché taillé dans la pierre mesure 14 mètres. Il est magnifique. Assis dans l'herbe à l'ombre, on ne se lasse pas de l'admirer. Le granite gris est taillé avec une finesse étonnante. Pour donner l'échelle sur la photo, Antoise va se placer auprès de la statue. Malheur ! qu'avons-nous fait là ! nous avons fâché deux policiers, mais où est le problème ? On a tout à fait le droit de s'approcher de la statue ; on a aussi tout à fait le droit de la photographier. Ce qui est interdit, c'est de photographier quelqu'un avec Boudha... On a eu quelques difficultés à comprendre...
Sur l'ensemble du site, les briques ont mal résisté au temps, et les pierres sont souvent tombées. Il n'y a plus aucune trace visible de rue ni d'habitations. Bref, une vision très irréelle de ce que devait être cette ville royale, et l'agréable sensation de vivre un moment privilégié.
Au retour, nous ne pouvons pas monter sur le site de Sirigia. Cette forteresse du Vè siècle n'est accessible qu'après une montée vertigineuse, et nous arrivons trop tard et trop fatigués, la nuit commence à tomber.
La journée a été chaude et poussiéreuse, nos vêtements sont chargés de sueur. Dîner merveilleux à l'hôtel.
Ce matin, le véhicule n'est pas là à 8 heures comme prévu, alors nous partons à pied à la gare avec dans la poche deux billets pour le wagon panoramique. C'est le mari de notre hôtesse qui nous les a vendus. Il travaille dans un hôtel de la ville et ces billets avaient été réservés pour des clients qui ont renoncé au voyage. C'est une chance pour nous car normalement, il faut réserver ces billets plusieurs jours à l'avance.
Ce qui m'embête dans ce contretemps, c'est que j'ai laissé hier le Lonely Planet dans le minicar. J'espérais le récupérer ce matin. Je ne peux pas m'empêcher de soupçonner le chauffeur d'avoir volontairement "oublié" de venir ce matin.
Je commence le voyage en seconde classe alors que les trois autres se tassent sur nos deux places réservées. Après une heure de trajet dans un wagon bondé, et grâce une longue explication avec le contrôleur, j'obtiens de voyager dans le panoramique. La présence de Younn a semble-t-il joué en ma faveur. Comment supporter dans ce pays que l'on puisse séparer une mère et son enfant ? Il a simplement fallu payer un supplément, et un bakchich ! Le voyage est donc plus confortable que les précédents. C'est le dernier wagon, et il est très vitré. Les sièges sont tournés vers l'arrière, si bien que nous avons une vue imprenable. Le trajet que nous allons faire traverse les plus hautes montagnes du pays et promet d'être spectaculaire. Malheureusement, le wagon est occupé par un groupe de voyageurs "troisième âge" allemands. Ils ont coupé les fans et n'ouvrent pas beaucoup les fenêtres. Résultat, il fait très chaud et l'air est étouffant.Je préfère le marchepied ; au moins j'ai de l'air, et je profite complètement du paysage magnifique. Susan fait pareil sur l'autre côté. Elle traduit bien la situation :
- Ces voyageurs en groupe dégagent une odeur vraiment désagréable !
Le paysage est fantastique. La verdure des plantations de thé est extraordinaire sous le soleil vertical. Quelques torrents émergent des rocailles et des petites parcelles en terrasses contribuent à cette harmonie verte.
Des femmes choisissent et coupent minutieusement à la main des feuilles de thé, et les mettent dans des grands paniers qu'elles portent sur leur dos. Elles ont des vêtements plus colorés que tout ce qu'on a vu jusque là, et qui rappellent l'Inde : saris roses, mauves, oranges. En fait, ce sont pour beaucoup des femmes originaires du Tamil-Nadu qui à l'origine venaient saisonnièrement pour le café. En 1870, un parasite a détruit les plans de café, qui ont été remplacés par des théïers. Le thé se récoltant toute l'année, les familles tamoules se sont installées sur l'île. Elles forment maintenant un sous-prolétariat qui pose problème au gouvernement.
Sri Lanka est au 3è rang des producteurs de thé au monde et au 2è rang des exportateurs.
Trois grandes catégories de thé selon l'altitude :
- "Low-grown" jusqu'à 600 mètres. Ne sert qu'à faire des mélanges ; pas très rentable.
- "medium grown" de 600 à 1300 m.
- "high grown" au-dessus de 1300 :. C'est le plus recherché mais il pousse beaucoup moins vite.
Après la cueillette , le thé est flétri, roulé, et séché.
Dans le thé de première qualité (Flowery Orange Pekoe et Flowery Broken Pekoe Fannings), n'entrent que les bourgeons terminaux très parfumés. Les anglais préfèrent le B.O.P. (Broken Orange Pekoe), savant mélange de feuilles et de bourgeons.
Le trajet est long. Le groupe de touristes descend une heure avant notre arrivée. Nous pouvons prendre nos aises aux meilleures places, et siroter les boissons achetées au petit comptoir crasseux qui porte abusivement le nom de "wagon restaurant". Antoine est fiévreux. Nous Arrivons vers dix-sept heures à Ella, sans aucune idée de l'endroit où nous pourrons dormir.
Sur le quai sont entassés des sacs de légumes : pommes de terre, poireaux, choux, et autres non identifiables. Au village, pas de tuc-tuc. Dans l'hôtel de la gare, pas de place. Après que Susan ait passé quelques coups de téléphone aux hôtels et aux pensions du coin, nous partons à pied, guidés par des villageois très sympathiques, vers le "Lizzie Lodge". Les chambres sont tristes, sans fenêtres, comme des cellules de moines. La salle de bains commune est des plus rudimentaires. Déception. Ella est dans un site merveilleux, entouré de sommets ; c'est vraiment dommage que de la terrasse de l'hôtel on ne puisse voir qu'une petite vallée sans beaucoup de perspective. Il aurait fallu téléphoner ce matin ou hier pour réserver...
Nous allons dîner au resthouse, à quelques centaines de mètres de notre hôtel. Nous sommes à environ 1200 mètres, la température est agréable et la vue sur la vallée de la Kirindi Oya est splendide : la fin du jour donne aux montagnes des reflets violets qui se perdent dans la brume du soir. Au retour (à pied) vers notre hôtel, nous achetons des médicaments pour Antoine, à l'épicerie du village. Nous décidons de partir demain pour la côte sud. Il faudra appeler au port de Galle pour prévenir Bruno du moment de notre arrivée.
Antoine et Susan ont chacun leur chambre. Younn a dormi à côté de moi. Je le trouve très calme. Il ne se plaint de rien malgré des conditions matérielles très sommaires et une organisation approximative. Dans la journée, il passe beaucoup de temps à rêver, et à lire. Chaque arrêt dans un hôtel est l'occasion d'avancer le travail scolaire, et il le fait sans rechigner. Bravo. Pour moi, ce périple est merveilleux ; j'y découvre chaque instant des situations nouvelles, j'y puise des connaissances, je me construis des souvenirs. Le dépaysement est total, à cause des lieux, mais aussi parce que nous sommes dégagés des contraintes sociales habituelles. Instants rares et précieux.
Nous prenons la route dans un minicar avec un chauffeur et un guide. Présentations :
- My name is JP (prononcer "Djépy")
- Ouah ! comme Le JP ! s'exclame Younn qui n'en revient pas...
Younn et moi, en aparté nous remarquons qu'il est rondouillard comme nôtre JP, qu'il lui ressemble un peu, en plus brun, et qu'il est donc forcément sympathique. Notre analyse subtile se révélera tout à fait juste. Djépy est guide officiel. Il m'a montré sa carte du gouvernement. Il accompagne le chauffeur dans le minicar jusqu'à Galle. Nous croyons comprendre que le chauffeur est un guide en formation. Djépy connaît bien son pays et sa région, et nous apprend beaucoup de choses sur la vie locale. Il parle bien anglais et Susan peut nous traduire beaucoup de ce qu'il dit. Grâce à lui, nous visitons un atelier de potier dans la région de Tanamalwila. Depuis plusieurs kilomètres, nous pouvions voir des marchands de poteries sur le bord de la route, et je ne pouvais plus résister.
- Pouvons nous visiter un atelier de potier ?
Djépy semble surpris et me répond :
- Vous voulez acheter de poteries ?
- Non, ce n'est pas ça. Je voudrais voir comment travaillent les artisans.
Il me fait signe que l'on pourra s'arrêter plus loin. Il semble connaître un potier qui pourra nous expliquer son travail. Je suis ravie.
Nous entrons chez les artisans. L'homme n'est pas là, mais les femmes nous montrent le tournage des pots, la mise en forme, le four... Je pose des tas de questions, Susan traduit, Djépy aussi, et c'est passionnant. La terre est récoltée au bord des rizières, mais pas n'importe lesquelles, il faut faire plusieurs kilomètres pour accéder aux zones autorisés. L'argile est malaxée et entassée sous des toiles devant la maison, en monticules pointus. Ce n'est qu'après deux ou trois jours de fermentation que la terre est mise en forme. Normalement, c'est l'homme qui utilise le tour, mais en son absence sa femme s'y installe. Elle doit avoir une vingtaine d'années. Sa mère actionne une manivelle à l'aide d'un long manche de bois. Tout se passe au ras du sol. Je suis fascinée. Nous sommes dans une petite maison peu éclairée, dans laquelle vit toute la famille. L'atelier et les pots empilés le long des murs ne laissent pas beaucoup d'espace pour les autres activités. La cuisine est dans coin obscur. Derrière un rideau, on peut deviner un lit de bois.
La potière fait monter entre ses doigts un pot ventru. Tout se passe dans une harmonie de tons chauds, la couleur de la terre se confond avec celle de la peau des mains qui la travaillent. L'opération ne dure pas plus de deux minutes. La base du pot est découpée au fil de fer, puis c'est assise par terre que la potière tape sur les bords avec une pelle en bois pour former le fond arrondi. Ses gestes sont rapides et sûrs. Elle tape, trempe la pelle dans de l'eau, la passe de temps en temps sur un chiffon humide puis tape à nouveau. Le pot fini est mis à sécher auprès de dizaines d'autres, tous identiques, sous le bord du toit dans la pièce principale de la maison. Le four est à l'extérieur : c'est un vaste trou dans lequel sont disposés des centaines de poteries, de toutes les tailles, alternant avec des couches de fibre de coco. Le tout est recouvert de terre, puis le feu est allumé à partir d'un petit couloir à la base de la fosse. La cuisson dure deux jours. La potière répond gentiment à toutes mes questions ; on apprend que plus de la moitié de la production casse pendant la cuisson ; les déchets de cuisson forment des tas autour de la maison...
Je prends des photos. Nous jouons au reporter-ethnologue. Je suis émerveillée de toucher de si près les techniques ancestrales de poterie. C'est pour moi comme un retour au Néolithique.
Avant de quitter l'atelier, je veux acheter quelques pots. Djépy négocie lui-même : il ne veut pas que je paie plus de 65 roupies pour un réchaud et un pot. Cela me semble vraiment peu cher, mais il insiste. C'est le bon prix. Il est opposé aux tarifs spéciaux "touristes" ; il ne faut pas donner trop de valeur aux produits artisanaux, sinon l'économie locale risque de se délabrer.
Quelques kilomètres plus loin, halte chez un producteur de curd et de trikle. Le curd, c'est le yaourt local. Il est fabriqué avec du lait de bufflesse bouilli puis fermenté. Il est vendu dans des pots de terre cuite assez plats, de la taille d'une assiette à soupe bien creuse. Ces pots sont fermés avec du papier journal, empilés et ficelés, et vendus par trois ou quatre. Les pots sont apparemment jetables, à moins qu'ils ne soient consignés, mais je ne crois pas. Le curd peut se conserver ainsi sans problème trois jours. La boutique est d'une extrême simplicité. On n'y trouve que du curd et du trikle. rien d'autre. Le trikle, sucre de palme liquide ; est vendu dans des bouteilles suspendues au-dessus de la porte et de la fenêtre. Devant la boutique, une petite table et deux chaises, juste ce qu'il nous faut pour consommer sur place.
Je trouve le mélange curd-trikle excellent. Susan préfère le curd nature, Younn et Antoine n'en ont pas repris.
Encore un arrêt : la réserve "Wirawila Tissa Bird Sanctuary". Djépy nous fait remarquer des pélicans en vol et des oiseaux blancs qui fréquentent les rizières. Antoine est à son affaire, il connaît bien les oiseaux, c'est un peu une déformation professionnelle (j'ai eu mon compte avec l'atelier de potier !). Nous voyons aussi un crocodile, au loin, affalé sur un rocher au milieu d'un plan d'eau, immobile. Dans l'eau il y a des buffles. Lorsque les crocodiles sont affamés, il paraît qu'ils attaquent, mais en temps normal, ils se content des carcasses des buffles morts. Tous ces buffles ne sont pas sauvages : dans la réserve, les troupeaux domestiques, que l'on trait pour le curd, côtoient les animaux sauvages.
La route est bordée de rizières. Antoine ne peut s'empêcher de chanter "J'étais dans les rizières..." de Vassiliu, et l'ambiance est à la gaieté. Dans les plaines comme celle que nous traversons, il n'y a que deux récoltes de riz par an. Djépy nous explique que sur les terrasses, les montagnards font une récolte de riz, une récolte de légumes, une récolte de riz, une récolte de légumes. C'est tellement rentable que les cultures gagnent sur la forêt à un rythme fou : y a 30 ans, la forêt couvrait 65% du pays alors que maintenant elle n'en couvre plus que 27% !. Dans la montagne il n'y a pas de noix de coco, tandis que dans la plaine il n'y a pas de légumes. Les sacs de légumes que l'on a vus sur le quai d'Ella partaient donc pour les plaines...
En regagnant le littoral, nous retrouvons des paysages familiers : cocotiers, petits commerces à touristes, plages...
Déjeuner à Tangalle dans un hôtel que je trouve triste et que Susan trouve "bizarre". Nous ne résistons pas à la proximité de la plage et prenons un bain. Comme souvent lorsqu'il y a du vent et des vagues, les autochtones nous mettent en garde face au danger, surtout pour un enfant. Bien sûr cela ne me rassure pas, et dès que je vois Younn disparaître sous une vague, je me dis qu'il est noyé. Le temps paraît interminable avant de voir sa tête ressortir de l'eau. Après quelques dizaines de minutes, saoulés par les vagues et quelque peu affamés, les adultes se retrouvent attablés sur le haut de la plage. Younn se baigne sans surveillance. Je ne cache pas mon inquiétude. Il n'y a peut-être pas autant de danger qu'on le dit... Antoine me rappelle qu'avant, nous aussi on craignait les vagues. Le panneau "baignade dangereuse" nous menaçait à l'entrée de la plage du Kerou où nous allions en famille. Ce panneau a été enlevé il y a quelques années. C'est bien la preuve que les bretons ont appris à maîtriser les vagues. La crainte actuelle des cinghalais face aux rouleaux est comparable à celle de nos grands-parents. J'ai sans tort d'avoir peur quand Younn se baigne, d'autant plus qu'il se débrouille comme un poisson. Mais c'est plus fort que moi.
Nous rentrons à Galle en ligne directe par la route côtière. Quelques hôtels nous tentent... Nous avons bien envie de revenir par ici dès que possible.
L'Ilboued n'a pas bougé, Bruno non plus. Nous racontons nos découvertes, et nous faisons des projets pour nos derniers jours à Sri Lanka. Poser nos sacs dans un hôtel de la côte et ne rien faire en regardant Younn jouer dans les vagues conviendrait bien aux filles. Après une nuit de récupération, nous sommes prêts à repartir. Bruno et Antoine restent à Galle. Susan, Younn et moi, avons choisi la plage de Mirissa, à une trentaine de kilomètres vers l'est.
Et nous voilà installés dans deux bungalows au "Paradise hotel" de Mirissa, sous les cocotiers juste derrière la plage. Un climat de rêve, une plage magnifique, un restaurant qui prépare du poisson frais grillé excellent. Deux jours de farniente dans ce lieu magique, que rêver de mieux ?
Younn fait beaucoup de body dans les vagues et un peu de CNED dans la chambre. Susan est là, discrète, sympathique, gaie. Nous parlons de son neveu Andrew qui pourrait être correspondant de Younn. L'idée plaît tellement à Younn qu'il lui écrit une lettre en anglais pendant le dîner, sur un coin de notre table, entre les plats de poisson et les bouteilles de bière.
J'ai de nombreuses discussions avec Susan et nous prenons le temps de mieux nous connaître. Elle me parle d'elle, de la première partie du voyage entre la Malaisie et Sri Lanka, de Younn, et une complicité s'installe entre nous.
Nous formons un trio enthousiaste, mi-anglophone, mi-francophone (surtout francophone) et nous profitons à fond de ces moments de bonheur, qui ne pourront pas durer longtemps.
Ca y est, c'est la fin des vacances. Ces deux jours d'inaction à Mirissa m'ont donné le temps de penser à JP et aux filles. Je dois leur manquer. Et je serai tellement contente de les retrouver. Je ne suis pas déchirée entre ici avec Younn et là-bas avec eux. Je sais que ma place est ici en ce moment et sera là-bas dans trois jours. Mais je suis tout de même étonnée de ne pas souffrir trop de l'absence de JP auprès de moi. Sans doute que Younn reçoit tout ce que je peux donner, et que je suis comblée par cette relation particulière. Pour l'heure, il est temps que je rentre. La curiosité et l'activité dont j'ai fait preuve depuis notre arrivée s'épuisent. Je pense au retour, à la proche séparation d'avec Younn, aux retrouvailles avec les autres qui sont à leur place aussi là-bas. Pourquoi s'inquiéter et s'attrister d'une séparation que nous avons sinon souhaitée, au moins acceptée et préparée ? Cette séparation, je la vis sereinement ; je connais sa nécessité.
Il faut maintenant regagner Galle et l'Ilboued.
Les préparatifs de départ sont un peu précipités. Paul est arrivé, sympathique et enthousiaste. Tout le monde est rassuré. Bruno fait des listes de matériel et de nourriture à mettre à bord. Je prend en charge une petite partie du travail mais Susan, Paul et Bruno font le plus gros. Tout s'organise bien, l'équipage est optimiste. Ilboued doit atteindre l'archipel des Marquises dans quelques jours.
Pendant que les cales du bateau se remplissent d'eau, de gasole, et de provisions, je vais à la plage avec Antoine et Younn, et nous profitons bien de nos derniers moments merveilleux dans l'eau avec les tortues d'Unawatuna.
Antoine, qui est maintenant un habitué des ballades sur la plage, s'y est aventuré seul, une fois de trop : il s'est fait voler son portefeuille. Pourtant, il avait pris la précaution de mettre sa pochette sous sa tête avant de s'endormir. Mais quand on fait la sieste sous les cocotiers, les pieds dans l'eau, il ne peut rien arriver, n'est-ce pas ? Il ne s'est aperçu de rien. Heureusement, son passeport était resté à bord. Un coup de fil en France pour annuler la carte bleue, ce n'est pas plus compliqué que ça.
Chacun fait son sac, les soutes se remplissent de vivres et de boissons. J'ai fait des derniers comptes avec Bruno. J'ai glissé dans un caisson une bouteille de vin australien qu'ils boiront en mer le jour de l'anniversaire de Susan. J'emporte les devoirs de Younn pour les envoyer au CNED. Voilà. Il faut rejoindre la gare. On laisse l'Ilboued à quai, on le retrouvera dans 5 mois, en Bretagne.
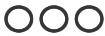
On se retrouve à Sri Lanka...AA
posté les 02/10/2018 par Bruno vue(s)806













